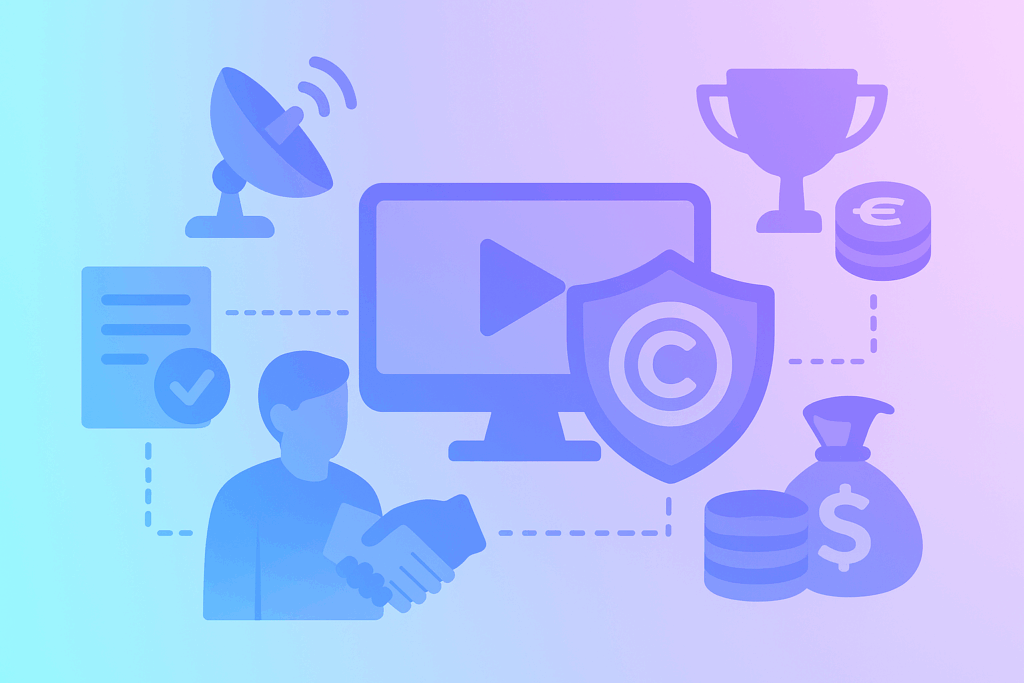Le streaming d’événements sportifs et e-sportifs n’est plus un relais d’image : c’est aujourd’hui la principale source de valeur d’une compétition. Or, la diffusion en ligne repose sur un faisceau complexe de droits de diffusion, de règles de propriété intellectuelle et d’obligations réglementaires. Comprendre ce cadre est indispensable pour sécuriser ses accords de streaming, optimiser ses revenus et se prémunir du piratage.
1. La source des droits de diffusion : propriété intellectuelle, droit du sport et spécificité e-sport
D’abord, toute retransmission communique une œuvre au public. Les images d’un match de football ou le gameplay d’un jeu vidéo sont protégés par le droit d’auteur et, le cas échéant, par les droits voisins des organisateurs et commentateurs.
Pour le sport traditionnel, l’article L. 333-1 du Code du sport confère à la fédération délégataire un monopole d’exploitation audiovisuelle. En e-sport, la situation diffère. En effet, le titulaire initial reste l’éditeur du jeu, qui peut concéder ou réserver la diffusion du « spectacle esportif ». Le contrat de licence détermine donc qui, de l’éditeur, de l’organisateur ou d’un diffuseur tiers, disposera du droit exclusif de streamer la compétition. Sans cette autorisation, tout flux constitue une contrefaçon.
Dans les disciplines sportives classiques, l’accord de diffusion s’appuie sur la cession du droit voisin de l’organisateur. Dans l’e-sport il repose sur la licence du jeu et, souvent, sur une cession complémentaire du signal de production. Ainsi, avant toute négociation commerciale, identifiez précisément la chaîne des droits : code, œuvres incorporées (musiques, logos, interface) et commentaires.
2. Négocier un accord de streaming : éditeurs, organisateurs, plateformes
Ensuite, la valorisation passe par une architecture contractuelle tripartite. L’éditeur octroie à l’organisateur le droit de mettre en scène la compétition, mais peut conserver la diffusion mondiale ou la céder territoire par territoire. Cette exclusivité justifie le montant du « rights fee » payé par une plateforme ou par une chaîne.
Dans l’e-sport, la concurrence entre plateformes accroît la valeur. L’accord doit couvrir la langue des commentaires, les formats (live, VOD, clips), la fenêtre d’embargo et les sous-licences publicitaires. Les recettes se répartissent entre minimum garanti, part variable sur les abonnements et sponsoring intégré. En pratique, l’éditeur exige un reporting détaillé des minutes vues, indispensable pour contrôler les reversements et adapter la stratégie de monétisation.
Enfin, prévoyez une clause « anti-piratage » imposant à la plateforme de recourir aux notices DSA et aux « trusted flaggers » européens pour retirer les flux illicites dans les délais réglementaires.
3. Obligations réglementaires et responsabilité des plateformes
La Digital Services Act (DSA) impose depuis février 2024 aux très grandes plateformes de retirer promptement tout flux illicite signalé, de coopérer avec les autorités et d’offrir un accès à leurs algorithmes d’amplification. En France, l’Arcom dispose du pouvoir de bloquer en urgence les sites de streaming sportif pirates. Elle a ordonné la fermeture de 1 922 services illégaux en 2024, nouveau record. Les diffuseurs légaux doivent donc intégrer un plan de notification-retrait, désigner un point de contact Arcom et respecter le décret « SMA » sur la publicité et le parrainage, qui s’applique également aux plateformes vidéo.
Parallèlement, le RGPD encadre la création de comptes mineurs sur les plateformes. Par exemple, Twitch interdit l’accès aux moins de 13 ans et exige le consentement parental jusqu’à 15 ans. Tout accord de diffusion doit donc prévoir des garanties de conformité DSA, RGPD et ARCOM, sous peine de suspension du flux et de pénalités contractuelles.
4. Prévenir les litiges et protéger vos revenus
Enfin, la sécurisation juridique se double d’une stratégie technique. Contractuellement, incluez :
- une clause de médiation obligatoire pour éviter la rupture en pleine saison ;
- un mécanisme d’audit‐tracking des revenus publicitaires programmatique ;
- une stipulation de résiliation accélérée en cas de manquements répétés au DSA.
Rappelez que la jurisprudence européenne a confirmé que la simple présentation passive d’une interface ne suffit pas à échapper au droit de communication au public. En d’autres termes, un site miroir reste contrefacteur.
Pour les titulaires de droits sportifs, la saisie-contrefaçon et le blocage DNS (une mesure technique qui empêche l’accès à un site Web en intervenant au niveau du « carnet d’adresses » d’Internet) restent les voies les plus rapides, tandis qu’en e-sport l’action repose sur la violation de licence et la concurrence déloyale.
Conclusion
La diffusion en streaming d’une compétition articule trois piliers : le monopole de propriété intellectuelle, l’ingénierie contractuelle et la régulation des plateformes. Identifier le bon titulaire des droits, formaliser une licence claire et respecter les nouvelles obligations DSA-Arcom sont les clés. Avant de signer, auditez votre chaîne des droits et exigez des garanties techniques de traçabilité. Vous éviterez des litiges coûteux et protégerez vos revenus futurs.
Deshoulières Avocats conseille et accompagne organisateurs, éditeurs et plateformes sur la rédaction et la négociation de contrats de diffusion, la mise en conformité DSA-RGPD et la défense contre le piratage.
RESSOURCES :
- « Le Digital Services Act : mode d’emploi« , Commission européenne
- Arcom, « La consommation illicite des programmes sportifs en 2024 »
- Deshoulières Avocats, « Qu’est-ce qu’un droit d’auteur ? »