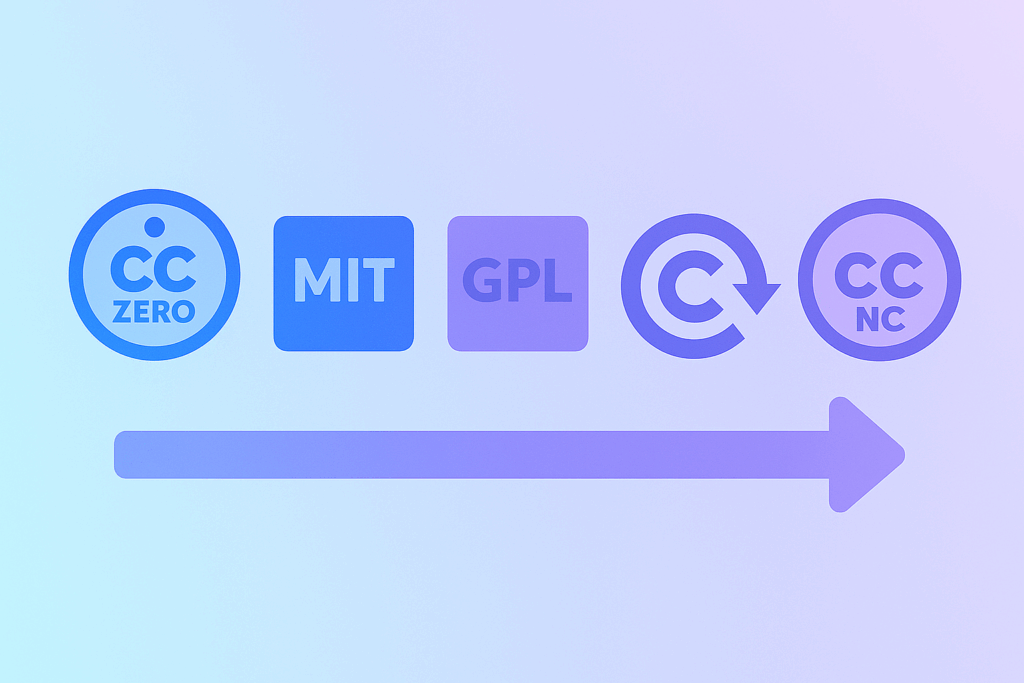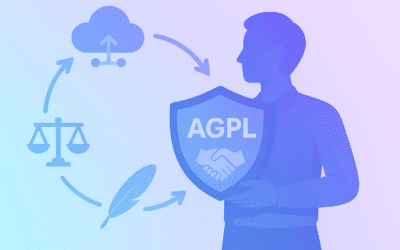Les licences libres structurent aujourd’hui une grande partie de l’innovation logicielle et créative. Or, faute de méthode, l’entrepreneur hésite souvent entre licence « copyleft » ou « permissive ». Ce guide vous propose une grille de lecture opérationnelle pour choisir une licence libre adaptée à votre projet.
Copyleft ou permissive : deux philosophies opposées mais complémentaires
D’abord, il importe de distinguer les licences dites « copyleft » des licences dites « permissives ».
- La première famille impose que chaque version dérivée reste soumise aux mêmes libertés. C’est la logique de la GNU GPL v 3 ou de la Licence Art Libre. Concrètement, l’utilisateur final est certain de conserver un accès au code source. Cette exigence est inscrite dans l’article L. 122-6-1 II du Code de la propriété intellectuelle qui consacre la décompilation pour interopérabilité. En pratique, cette contagion juridique favorise la coopération mais limite l’intégration dans des projets propriétaires.
- À l’inverse, la licence permissive (MIT, BSD, Apache 2.0) se contente, en général, d’exiger le maintien de la paternité et d’une clause de non-responsabilité. Grâce à l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur reste maître de ses droits patrimoniaux. Ainsi, il peut, s’il le souhaite, proposer parallèlement une licence commerciale.
Pour l’entreprise, le choix entre ces deux modèles dépend de la stratégie : sécuriser une communauté ou faciliter l’adoption par des partenaires industriels.
Un parcours historique, de la philosophie hacker aux modèles industriels
Replacer les licences libres dans leur chronologie aide à comprendre leur ADN.
Fin années 1980, la Free Software Foundation publie la première GPL : la dimension militante y domine, portée par le célèbre article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme qui évoque la liberté de circuler… y compris pour les idées. Durant les années 1990, les universités nord-américaines diffusent BIND, TCP/IP ou Sendmail sous licences BSD, convaincues que le partage sans contrainte accélère la recherche.
Au tournant des années 2000, la libération du navigateur Netscape engendre la Mozilla Public License. Les clauses deviennent plus fines, abordent la question des brevets (art. L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle) et s’adaptent aux contributions massives.
Aujourd’hui, la version 2.0 de l’Apache License illustre l’ère industrielle : compatibilité internationale, régime de brevet explicite et clarification de la responsabilité, conformément à la directive 2009/24/CE sur les programmes d’ordinateur. Connaître cette évolution permet au dirigeant de mesurer la portée juridique et la crédibilité commerciale d’une licence.
Adapter la licence au domaine créatif concerné
De plus, une licence n’est jamais neutre ; elle répond à un contexte.
- La GNU GPL protège parfaitement un logiciel, mais son formalisme (fourniture obligatoire du code source et de la licence complète) se révèle lourd pour un album de musique.
- À l’inverse, les Creative Commons BY-SA conviennent aux contenus éditoriaux ou audiovisuels, car elles imposent seulement la mention de l’auteur et le partage des adaptations sous les mêmes conditions.
Toutefois, elles ignorent la notion de « lien dynamique » propre aux bibliothèques logicielles et ne règlent pas la réversibilité de la base de données (art. L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle). Dans les œuvres multimédias, un jeu vidéo, par exemple, mélange moteur logiciel, graphismes et bandes sons. Il n’existe pas de solution unique. L’entrepreneur doit alors choisir entre une licence globale – souvent complexe – et une politique modulaire, chaque élément recevant la licence la plus pertinente. Là encore, un audit préalable évite les incompatibilités qui bloqueraient une levée de fonds ou un contrat de distribution.
Liberté pérenne, liberté fragile, liberté asymétrique : trois degrés à anticiper
Enfin, la Commission « œuvres libres » du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a proposé une classification par degré de liberté.
- La liberté pérenne est garantie par le copyleft. Chaque contributeur sait qu’il bénéficiera des améliorations futures, ce qui réduit les coûts de transaction.
- La liberté fragile caractérise les licences permissives : rien n’empêche un tiers de refermer le code dans une solution propriétaire. L’auteur renonce en partie à contrôler la chaîne de valeur, mais gagne en visibilité.
- Quant à la liberté asymétrique, elle naît lorsque certaines utilisations – commerciales ou dérivatives – sont interdites au public, alors qu’elles restent ouvertes au titulaire initial. Les clauses « Non Commercial » ou « No Derivatives » des Creative Commons en sont l’illustration. Le risque ? Un déséquilibre contractuel susceptible d’être sanctionné par l’article 1171 du Code civil sur les clauses abusives dans les contrats d’adhésion. L’entreprise devra donc intégrer, dès la phase de conception, l’objectif réel de diffusion – notoriété, standardisation ou service associé – pour calibrer ce niveau de liberté.
Conclusion
Choisir une licence libre n’est jamais anodin : elle fixe le cadre juridique des contributions, sécurise la conformité avec les articles L. 123-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et influence la rentabilité d’un modèle open source. Copyleft protège la communauté ; permissive séduit les intégrateurs ; Creative Commons ou LAL élargissent le champ créatif. Avant de publier, identifiez votre stratégie, vérifiez la compatibilité des composants et consignez vos choix dans un dossier interne. Un conseil : rédigez une charte de contribution claire ; elle facilitera les audits lors d’une levée de fonds.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans la sélection, la rédaction et la négociation de vos licences libres, afin de valoriser durablement votre propriété intellectuelle et de sécuriser vos projets.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1, L. 122-6 à L. 122-7, L. 131-3, L. 341-1.
- Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 sur la protection des programmes d’ordinateur.
- Creative Commons BY-SA 4.0 : Legal Code.
- Deshoulières Avocats, « Comment un logiciel est-il protégé par la propriété intellectuelle ?«