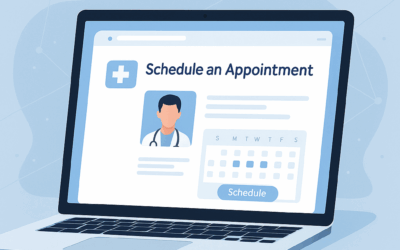Dans un reportage consacré au professeur Didier Raoult, la reconstitution de son bureau a donné lieu à la reproduction d’une toile de l’artiste Noyps. Le Tribunal judiciaire de Paris (10 septembre 2025, n° 23/07780) a condamné les sociétés impliquées : 14 000 € de dommages et intérêts, mesures de retrait, d’interdiction et de destruction. À la clé, deux rappels utiles : le droit moral protège l’“esprit” de l’œuvre, mais pas tout contexte polémique ; et la « théorie de l’accessoire » ne couvre pas une inclusion délibérée d’une œuvre dans un film.
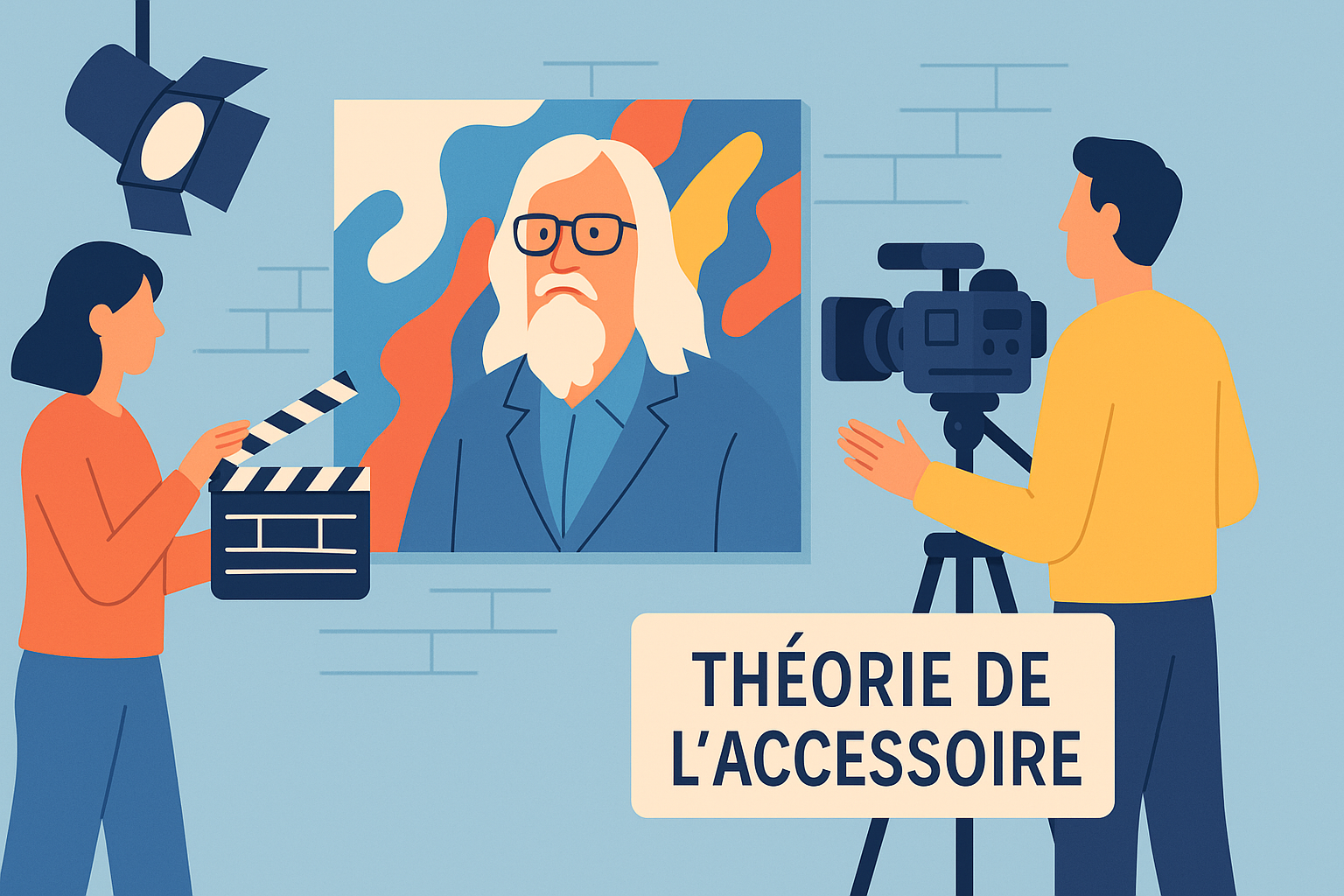
1. Un tableau recréé pour un tournage : pourquoi c’est problématique
Les faits sont simples : une toile avait été réalisée pour l’institut où exerce le professeur Raoult et accrochée au mur de son bureau. De nombreuses interviews y avaient rendu le décor reconnaissable. Pour un documentaire télévisé intitulé « La face cachée de [U] [K] : les dessous d’une incroyable controverse », diffusé à partir de 2021, la production a reconstitué le bureau… en reproduisant matériellement l’œuvre sur un nouveau support. Résultat : l’original et sa copie apparaissent à plusieurs reprises à l’écran.
L’artiste a réagi immédiatement, puis a assigné en 2023 les sociétés ayant participé à la création et à la diffusion du reportage, sur le fondement de ses droits patrimoniaux (droit exclusif de reproduction et de représentation) et de ses droits moraux (paternité et respect de l’œuvre). Par jugement du 10 septembre 2025, la 3e chambre, 3e section, du TJ Paris a condamné les défenderesses : 14 000 € de dommages et intérêts et mesures de retrait, d’interdiction et de destruction de la copie illicite. Pour les producteurs et diffuseurs, la leçon est claire : reconstituer un décor ne donne aucun passe-droit pour copier une œuvre protégée, même si elle « fait partie du lieu ».
2. Droit moral : ce qui relève (ou non) du respect de l’œuvre
Au-delà de la contrefaçon patrimoniale, l’artiste invoquait deux atteintes à son droit moral : paternité et respect de l’œuvre. Sur le respect matériel (intégrité physique), il soutenait que l’œuvre, placée « derrière une machine à café » ou filmée de manière tronquée, avait été « amputée ». Le tribunal adopte une ligne pragmatique : filmer l’œuvre partiellement ou avec un élément de décor devant elle n’altère pas l’œuvre elle-même. En d’autres termes, une captation qui cadre serré ou masque partiellement ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une dégradation de l’objet protégé.
Restait la question, plus subtile, du respect de l’esprit de l’œuvre (son « intégrité spirituelle »). L’artiste plaidait que l’association de son tableau à la personnalité controversée du professeur mis en cause dénigrait son travail et portait atteinte à sa réputation. Le tribunal rejette : si le commentaire du film explique que les œuvres exposées « reflètent la personnalité » du professeur, aucune critique directe ne vise l’œuvre elle-même. Il n’y a donc pas, selon le juge, atteinte à l’esprit de l’œuvre par simple association avec un personnage discuté.
Pour un public non juriste, retenons ceci : le droit moral permet à l’auteur de s’opposer aux déformations d’une œuvre et, dans certains cas, à des contextes d’utilisation préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. Mais toutes les associations polémiques ne tombent pas automatiquement sous le coup de ce droit. Il faut des éléments ciblant l’œuvre (ou l’auteur via son œuvre) et non une critique générale d’un protagoniste du film. Faute de quoi, l’atteinte à l’esprit n’est pas caractérisée.
3. La théorie de l’accessoire : fortuité exigée, intention prohibée
Pour se défendre, les sociétés invoquaient la théorie de l’accessoire : lorsqu’une œuvre apparaît accessoirement dans une image (par exemple, une peinture en arrière-plan d’une scène), il n’y aurait pas de véritable « communication au public » au sens du droit d’auteur. La jurisprudence française admet, de longue date, que l’apparition fortuite, imbriquée au sujet, ne porte pas atteinte au monopole de l’auteur.
Le tribunal rappelle l’esprit de cette construction : elle vise les inclusions non voulues (le cadre passe sur une affiche, un logo, une œuvre au second plan, sans intention d’exploiter l’œuvre). Autrement dit, l’accessoire suppose la fortuité. Ici, au contraire, la production a voulu reconstituer le bureau et la toile ; elle a délibérément reproduit l’œuvre sur un support physique. Nous ne sommes plus dans l’« arrière-plan qui traîne dans le champ », mais dans un choix de mise en scène qui requiert l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit. D’où le rejet de la théorie de l’accessoire.
Point pratique important : en France, la théorie de l’accessoire n’est pas une « exception » écrite dans la loi au même titre que, par exemple, la courte citation. C’est une limite jurisprudentielle : lorsqu’elle s’applique, on considère qu’il n’y a pas d’usage pertinent des droits de l’auteur, parce que l’œuvre n’est qu’un détail fortuit lié au sujet filmé. Dès qu’il y a intention (reconstruction, cadrage appuyé, répétition, mise en avant), la porte se referme : il faut un accord.
A retenir :
Cette affaire illustre une ligne de crête simple à retenir : filmer un espace où une œuvre apparaît par hasard peut, dans certaines limites, rester en dehors du droit d’auteur ; recréer délibérément cette œuvre pour un tournage, non. Pour éviter la contrefaçon, on demande l’autorisation ou on s’en passe. Et si débat moral il y a, il doit viser l’œuvre elle-même — pas seulement la personnalité de celui chez qui elle est accrochée.
***
Pour toute demande de conseil juridique, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez dès à présent demander un devis gratuit ici.