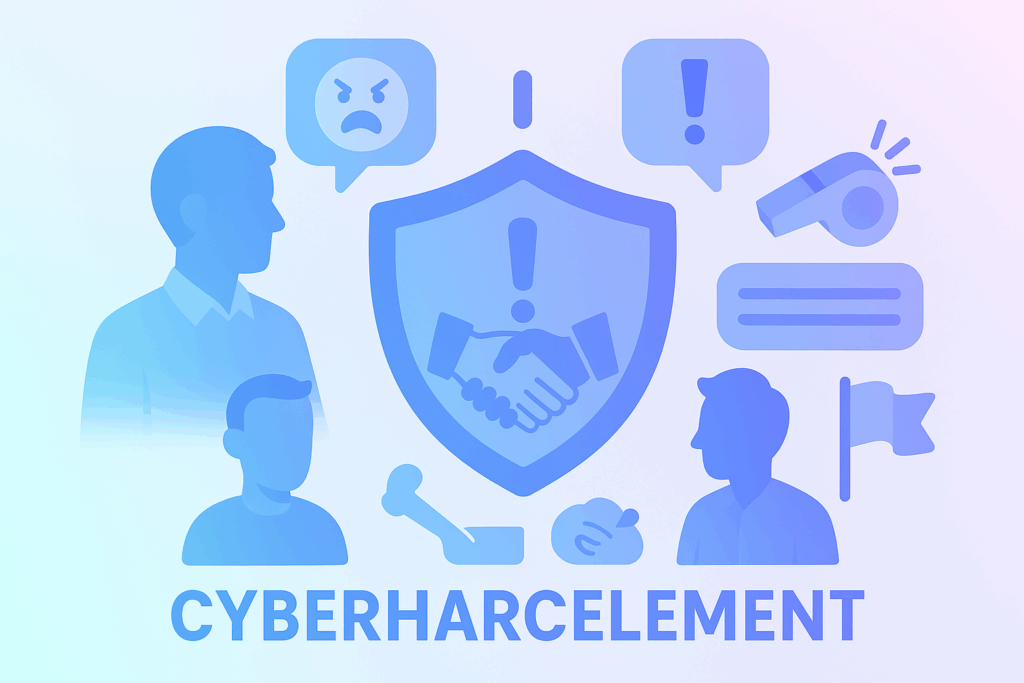Le cyberharcèlement pendant une partie de jeu vidéo ne relève pas d’un simple désagrément. Il met en cause la responsabilité civile, pénale et parfois contractuelle de l’organisateur, qu’il s’agisse d’un éditeur, d’une plateforme d’e-sport ou d’une association. Dans un environnement où la propriété intellectuelle protège aussi bien le code source que la marque du jeu, la maîtrise du risque réputationnel devient stratégique.
Un cadre européen en pleine mutation
Depuis le Digital Services Act (règlement 2022/2065), toutes les plateformes qui « désignent les destinataires du service » – serveurs officiels ou espaces communautaires – doivent offrir un mécanisme de signalement simple et accessible pour les contenus illicites, dont le cyberharcèlement. L’obligation pèse même sur les petites structures dès lors qu’elles dépassent 50 salariés ou 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Le DSA impose :
-
un traitement rapide des notifications (article 16) ;
-
un feedback motivé à l’utilisateur (article 17) ;
-
la transparence sur les algorithmes de recommandation (article 27).
Le non-respect expose à des amendes jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires mondial. Parallèlement, la CNIL rappelle que les messages privés contiennent des données personnelles. Ils doivent être conservés aussi brièvement que possible et chiffrés lorsqu’ils transitent hors UE. Enfin, la Q&A DSA publiée par la Commission précise que les tournois ponctuels restent soumis à ces règles dès qu’ils utilisent un canal de communication public intégré au jeu.
Ces textes fixent une grille commune, mais la jurisprudence sportive apporte une dimension supplémentaire : un devoir de prudence général à la charge de l’organisateur. Ce devoir est calqué sur l’obligation de sécurité que l’on trouve dans le droit du sport.
Obligation de sécurité numérique : une transposition des principes sportifs pour lutter contre le cyberharcèlement
Le juge civil considère depuis longtemps que l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’une obligation de sécurité de moyens, voire de résultat pour les publics vulnérables. Transposée au jeu vidéo, cette logique signifie : offrir un environnement technique raisonnablement sûr.
Concrètement, il faut :
-
choisir une solution d’hébergement protégée contre les attaques DDoS. Une attaque DDoS (pour Distributed Denial of Service, ou « déni de service distribué ») consiste à saturer un serveur ou un réseau sous un énorme volume de requêtes provenant de multiples ordinateurs, souvent infectés par un logiciel malveillant et coordonnés. L’infrastructure visée ne parvient plus à répondre aux requêtes légitimes. Ainsi, le service – par exemple un site web – devient alors lent ou totalement indisponible pour les utilisateurs.
-
configurer des filtres anti-spam et anti-insultes avant l’ouverture du chat ;
-
désigner un staff joignable en temps réel pour gérer les incidents.
La charge de la preuve s’inverse souvent. En cas de dommage, l’organisateur devra démontrer qu’il a mobilisé tous les moyens utiles pour prévenir le cyberharcèlement, à l’image du sport où il doit justifier le respect des règles techniques.
Le Code civil n’a pas été écrit pour les parties en ligne. Pourtant l’article 1242 (responsabilité du fait d’autrui) s’applique lorsque le joueur mineur, placé sous la surveillance du staff, commet un acte injurieux. L’article 1240 (faute personnelle) couvre les manquements de modération. Les organisateurs disposent d’assurances « risques cyber », mais ces polices excluent souvent les dommages immatériels subis par les victimes. Il est donc conseillé de vérifier les clauses « atteinte à la e-réputation » avant toute compétition.
Modération du chat : de la prévention à la réaction
La meilleure stratégie reste préventive.
- Première étape : paramétrer un filtre lexical mis à jour, incluant variantes et emojis.
- Ensuite : former les modérateurs. Un simple bénévole, sans procédure écrite, engage la responsabilité de la structure s’il tarde à bloquer des propos haineux. Le DSA exige d’ailleurs que les équipes soient « adéquatement formées » (article 20).
Sur le plan pratique :
-
Prévoir un cooldown (léger délai) entre deux messages limite les « raids toxiques ».
-
Activer la capture automatique des logs facilite la preuve des abus.
-
Afficher un code de conduite clair, accepté au login, renforce la licéité de la suspension de compte.
En cas de signalement, le traitement doit suivre quatre temps : accusé de réception, examen rapide, décision motivée, voie de recours interne. Ce processus réduit le risque de « ban arbitraire » et correspond à la logique de l’article 17 DSA.
Le rappel à la loi n° 2020-766 (création du délit de harcèlement en ligne – revenge trolling) protège le modérateur : il agit alors sous la couverture de l’« état de nécessité » (article 122-7 Code pénal). Pensez à l’inscrire dans la politique interne.
Sanctions et responsabilités en cas de cyberharcèlement : croisement du civil et du pénal
Le Code pénal sanctionne le cyberharcèlement (article 222-33-2-2) jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. L’organisateur qui n’a pas retiré, dans un délai raisonnable, un message manifestement illicite peut être poursuivi comme complice. Sur le plan civil, la victime peut solliciter la réparation de son préjudice moral et de son préjudice d’anxiété. Les tribunaux octroient de 1 000 € à 5 000 € pour des propos répétés sur un chat de jeu en ligne.
En cas de tournoi physique, l’organisateur présente aussi un devoir de surveillance comparable à celui reconnu dans le sport : installer une équipe de sécurité, contrôler l’âge des participants, exclure sans délai l’agresseur et préserver les preuves vidéo.
Le DSA ajoute une couche financière : le very large online platform risque la suspension du service dans l’UE si elle persiste à négliger les injonctions. Pour une PME, le danger principal reste la déréférence et la perte de confiance des sponsors. La couverture médiatique d’un scandale de cyberharcèlement peut entraîner une chute drastique de la valeur de la marque, protégée pourtant par le droit des marques.
Conclusion
Le cyberharcèlement in-game n’est plus un angle mort. Le DSA fixe un standard européen, la CNIL impose la maîtrise des données, et la jurisprudence sportive rappelle l’obligation de sécurité. Les organisateurs doivent donc auditer leurs outils de modération, former leurs équipes et documenter chaque mesure prise. Convaincu ? Faites-vous accompagner avant l’incident, pas après.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans la rédaction de conditions d’utilisation, la mise en place de protocoles de modération et la défense de vos actifs de propriété intellectuelle dans l’univers jeu vidéo.
RESSOURCES :
- DSA : Rendre le monde en ligne plus sûr, Commission européenne
- CNIL – Protège ta vie privée, cnil.fr
- Q&A Digital Services Act
- Code pénal, article 222-33-2-2
- Code civil, article 1242
- Deshoulières Avocats, « Cyber harcèlement : 8 conseils pour agir efficacement«