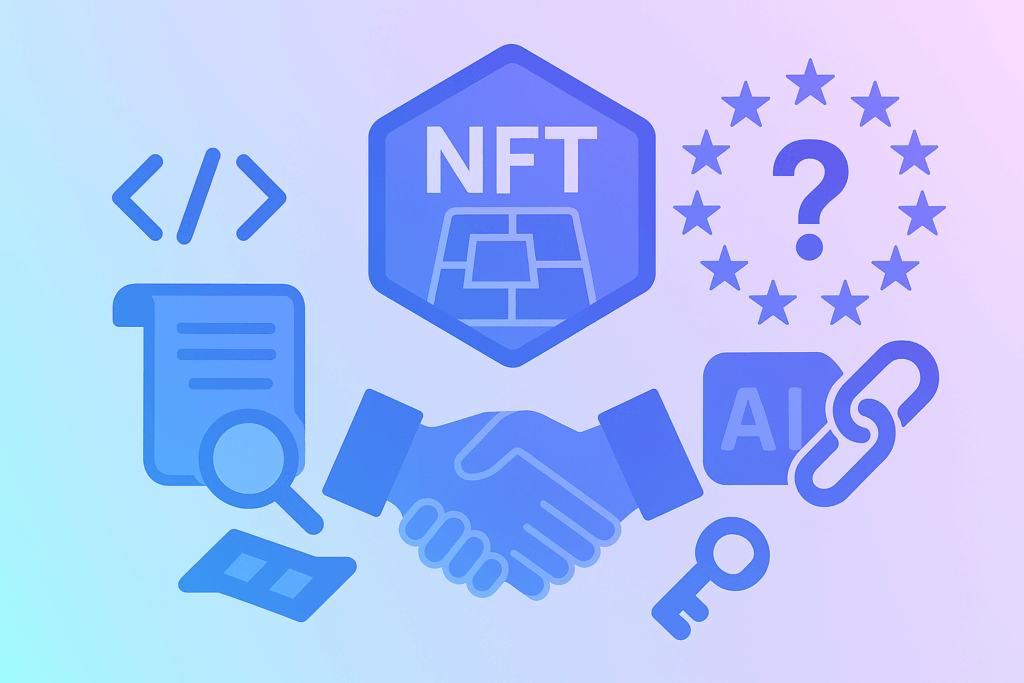Acheter un terrain virtuel attire désormais autant qu’un local commercial. Pourtant, la propriété virtuelle n’obéit ni au Code civil classique ni au cadastre. Entre ligne de code, jeton NFT et conditions d’utilisation des plateformes, l’investisseur doit donc se poser une question clé : qu’achète‑t‑il vraiment ? Les réponses mêlent droit de la propriété intellectuelle, contrat numérique et nouvelles régulations européennes.
Du code à la parcelle : quelle nature juridique pour un land ?
D’abord, un land n’est qu’un identifiant inscrit dans la base de données d’une plateforme ou, plus rarement, dans une blockchain publique. Le Code civil distingue les biens meubles et immeubles ; mais il range depuis longtemps les « biens incorporels » dans la catégorie des meubles (art. 527). Un terrain virtuel relève donc d’un bien mobilier numérique, régi par le droit commun de la propriété et, surtout, par le contrat qui le crée.
Ensuite, le jeton attribué constitue une preuve technique d’attribution. Néanmoins, il ne confère aucun droit réel sur les serveurs qui hébergent l’univers. Le propriétaire peut transférer ou céder son land comme tout actif incorporel, sous réserve des restrictions inscrites dans les conditions générales. Cependant, en cas de litige, seul le tribunal compétent et la loi applicable au contrat décident.
Enfin, l’article L.112‑2 du Code de la Propriété intellectuelle assimile le code source et les graphiques originaux à des œuvres de l’esprit : reproduire sans autorisation le visuel d’un land peut donc engager la responsabilité pour contrefaçon.
NFT, titre de propriété ou simple clé d’accès ?
Ensuite vient le NFT, souvent vendu comme un « titre de propriété ». Sur le plan juridique, il s’agit d’un certificat d’authenticité horodaté : il pointe vers des métadonnées décrivant le land. Cependant, le jeton ne transporte pas nécessairement les droits d’auteur ou d’exploitation ; il renvoie à un contrat de licence. Selon le World Economic Forum, 80 % des NFTs en 2023 conféraient uniquement un droit d’affichage limité (WEF Evolution NFTs 2023).
Ainsi, l’acquéreur dispose d’une clé d’accès, pas d’un droit absolu. Si la plateforme ferme ou migre, le NFT risque de devenir inutilisable. Pour limiter ce risque, insérez une clause d’interopérabilité dans l’acte de cession et vérifiez la pérennité de l’URL stockant les métadonnées. Par ailleurs, le régime fiscal français assimile les plus‑values sur NFTs à des actifs numériques (art. 150 VH bis du Code général des impôts), ce qui impose de déclarer les cessions.
Enfin, si le land accueille des créations (bâtiments 3D, expériences interactives), déterminez qui détient les droits sur ces contenus : l’exploitant, le développeur ou l’artiste ?
Plateformes et DSA : l’importance des conditions d’utilisation
Cependant, posséder un land n’exonère pas des règles imposées par la plateforme. Le règlement sur les services numériques (DSA) maintient l’immunité de l’hébergeur tant qu’il ignore l’illégalité d’un contenu et agit promptement après notification. L’article 16 impose en outre un mécanisme de signalement accessible à tous. Concrètement, la plateforme peut donc retirer un terrain ou geler un NFT si le contenu qu’il expose viole ses règles ou la loi.
Le contrat d’adhésion précise souvent qu’aucun « droit réel » n’est transféré, que la licence est révocable et que l’utilisateur supporte la perte en cas de fermeture. Pour l’entreprise, il est donc essentiel de lire les conditions générales d’utilisation : elles déterminent la surface virtuelle, la durée de jouissance et les limites commerciales (publicité, vente de marchandises, collecte de données). En cas d’incompatibilité avec votre projet, négociez un addendum ou choisissez une plateforme offrant des garanties de portabilité.
Exploiter son terrain virtuel : créations, marques et limites
Enfin, détenir un land ouvre des opportunités marketing : boutiques immersives, événements, placements de produit. Chaque action soulève des questions de propriété intellectuelle. L’architecture 3D originale bénéficie de la protection du droit d’auteur dès sa création (art. L.111‑1 du Code de la Propriété intellectuelle). Une marque placée sur une façade virtuelle doit être déposée pour les classes correspondant aux services métaversiens (Nice 45, par exemple).
De plus, le règlement DSA prévoit des obligations de traçabilité pour les marketplaces : si vous vendez des biens réels depuis le Metaverse, vous devez afficher l’identité de votre société, faute de quoi la plateforme perd son immunité et peut vous évincer. La publicité immersive doit respecter le RGPD et interdire les pratiques trompeuses.
Enfin, l’interopérabilité entre mondes virtuels reste limitée ; protéger vos actifs par une stratégie de dépôts (dessins et modèles, droits voisins sur les sons, base de données) reste la meilleure défense.
Conclusion
La propriété virtuelle naît d’un subtil mélange de code, de contrat et de droits intellectuels. Le jeton NFT matérialise l’attribution, mais c’est la loi applicable et les CGU qui fixent la portée des droits. Pour sécuriser votre investissement : vérifiez la licence, demandez des garanties de portabilité et protégez vos créations par des dépôts adaptés. Le cadre européen, encore en évolution, appelle à une vigilance continue.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans la sécurisation de vos actifs virtuels : audit juridique de lands, rédaction de licences NFT, protection de vos marques et défense de vos droits en cas de litige.
RESSOURCES :
- Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques
- Code de la propriété intellectuelle, art. L.111‑1 à L.113‑3
- Deshoulières Avocats, » NFT : un protocole technique, trois outils juridiques «