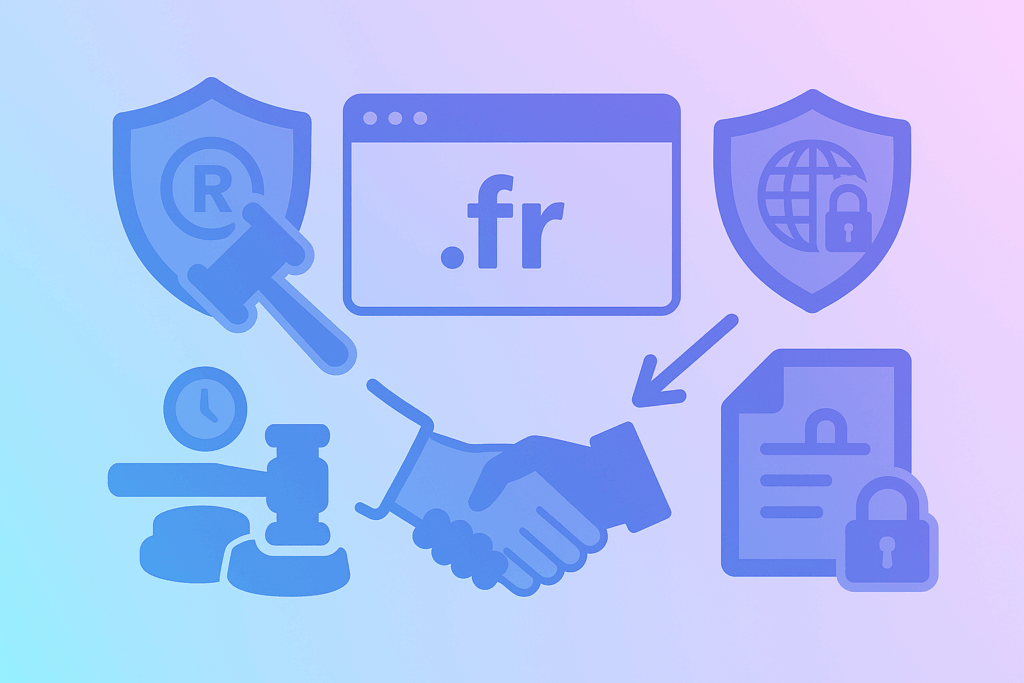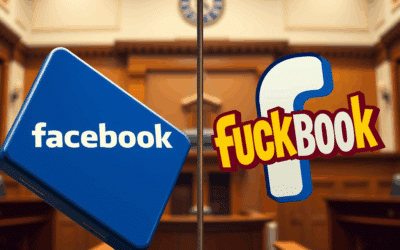Le nom de domaine et la marque forment aujourd’hui un duo stratégique : le premier guide l’internaute, la seconde rassure le consommateur. Pourtant, la collision entre les deux signes est fréquente et souvent brutale. Cumuler une action en contrefaçon de marque et une procédure spécifique au nom de domaine constitue alors le moyen le plus sûr d’obtenir, vite et fort, la cessation de l’atteinte.
Comprendre la dualité marque/nom de domaine
Un nom de domaine reste un simple « adresseur » : il localise un site au sein du DNS (Domain Name System, l’annuaire mondial d’Internet), sans conférer de droit privatif autonome. La marque, au contraire, octroie un monopole sur un signe pour des produits ou services donnés (principe de spécialité). Dès qu’un radical de domaine (c’est-à-dire la partie centrale que vous choisissez librement, située entre le préfixe éventuel et l’extension) reproduit la marque, deux sphères se recouvrent : la visibilité technique de l’adresse et la fonction garantie de provenance.
Or les bureaux d’enregistrement n’examinent ni disponibilité ni caractère distinctif avant de déléguer un nom de domaine ; la règle demeure « premier arrivé, premier servi ». De leur côté, les offices de marques vérifient la distinctivité mais pas l’usage réel en ligne. Cette asymétrie nourrit le contentieux.
Pour la résoudre, il faut d’abord qualifier l’usage litigieux : exploitation commerciale active, parking, cybersquattage, ou simple rétention défensive. Ensuite, on évalue la spécialité du site. La jurisprudence Locatour impose de comparer l’objet réel du site à la liste des produits et services couverts par la marque. Quand cette comparaison révèle un chevauchement, le terrain de la contrefaçon s’ouvre. Dans les autres cas, le titulaire devra pivoter vers la concurrence déloyale ou le parasitisme. Comprendre cette dualité marque/nom de domaine, et la place des différents fondements, conditionne donc toute stratégie de cumul.
Action en contrefaçon : fondement et portée
Les articles L716‑1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle autorisent le titulaire à interdire tout usage en ligne d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou connexes. Le juge vérifie quatre critères :
- risque de confusion,
- usage dans la vie des affaires,
- désignation de produits ou services,
- impact sur le territoire protégé.
Un nom de domaine exploité pour vendre des biens entrant dans la classe de la marque tombe donc directement sous le coup de la contrefaçon. Les sanctions possibles incluent dommages‑intérêts, interdiction d’usage, et surtout radiation ou transfert forcé du domaine au profit du titulaire lésé.
La Cour de cassation a toutefois rappelé que l’inexploitation d’un site prive souvent le titulaire de recours en contrefaçon, faute d’usage pour désigner des produits ou des services. La démonstration de l’usage reste donc décisive. Pour parer cette difficulté, confrontez vos captures d’écran, vos logs serveur et vos constats d’huissier ; ils prouveront l’activité commerciale réelle du défendeur.
En outre, l’action en contrefaçon bloque la prescription en matière de concurrence déloyale ; c’est une raison supplémentaire de la combiner avec d’autres leviers.
Procédures extrajudiciaires : levier complémentaire indispensable
Parallèlement à l’action en contrefaçon nom de domaine, le titulaire peut lancer une procédure administrative ciblée.
À l’international, l’UDRP gérée par l’ICANN et administrée par le WIPO exige de démontrer :
- identité ou similarité confuse,
- absence de droit ou d’intérêt légitime,
- enregistrement,
- et usage de mauvaise foi.
Syreli (AFNIC) et PARL Expert (pour le « .be ») adoptent des critères proches, tandis que la procédure ADR régit le « .eu ». Ces mécanismes présentent trois avantages : rapidité (60 jours en moyenne), coût modéré et absence d’aléa territorial ; le titulaire obtient quasi exclusivement le transfert ou la radiation. En outre, la décision extrajudiciaire sert de preuve forte de la mauvaise foi, utile devant le juge civil.
Cependant, elle ne permet pas d’obtenir des dommages‑intérêts. Cela explique l’intérêt du cumul marque : lancez d’abord l’UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) pour sécuriser le domaine, puis engagez la contrefaçon pour compenser le préjudice. L’effet psychologique est notable : le cybersquatteur, conscient de la double pression, préfère souvent négocier.
Stratégie de cumul marque et nom de domaine : bonnes pratiques
D’abord, auditez vos portefeuilles : listez vos marques et leurs extensions de domaine manquantes. Ensuite, surveillez les nouveaux dépôts via des alertes . Dès la détection d’un conflit, sélectionnez la combinaison la plus percutante :
-
Marque enregistrée + usage actif : action contrefaçon nom de domaine immédiate, assortie d’une demande de transfert.
-
Marque notoire + parking publicitaire : UDRP pour obtenir le transfert, puis action en concurrence déloyale pour récupérer les revenus générés.
-
Marque en cours de dépôt + enregistrement défensif bloqué : référé sur le fondement de l’article L716‑6 pour obtenir une mesure provisoire de gel du domaine.
Le cumul marque évite les angles morts : l’UDRP traite le nom de domaine globalement, tandis que le juge civil analyse finement la spécialité et le préjudice. De plus, combiner les deux voies crée un effet de cliquet : le titulaire sécurise d’abord le signe sur Internet, puis fait sanctionner le passé. Enfin, n’hésitez pas à activer l’article L45‑2 du Code des postes et des communications électroniques ; l’AFNIC peut radier un « .fr » enregistré de mauvaise foi, notamment en cas de cybersquattage spéculatif. Une seule démarche, plusieurs fronts : tel est le secret d’un impact maximal.
Conclusion
Le croisement entre marque et nom de domaine s’intensifie à mesure que l’économie se digitalise. Ne choisissez plus entre action contrefaçon nom de domaine et procédure administrative ; combinez‑les. La première offre la force du juge et la réparation financière. La seconde verrouille rapidement l’adresse litigieuse. Évaluez toujours l’usage réel, la mauvaise foi et la portée territoriale. Puis orchestrez un plan d’attaque séquencé : mise en demeure, UDRP ou Syreli, assignation en contrefaçon, calcul du préjudice, exécution forcée. Cette stratégie graduée sécurise vos actifs numériques, décourage les imitateurs et protège la valeur de votre marque à long terme.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne à chaque étape : audit de portefeuille, surveillance des dépôts, rédaction de mises en demeure, conduite des procédures UDRP/Syreli et plaidoyer devant les tribunaux spécialisés.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle, art. L716‑1 s.
- WIPO, « Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy »
- Deshoulières Avocats, « Litige de nom de domaine : comment agir ? »