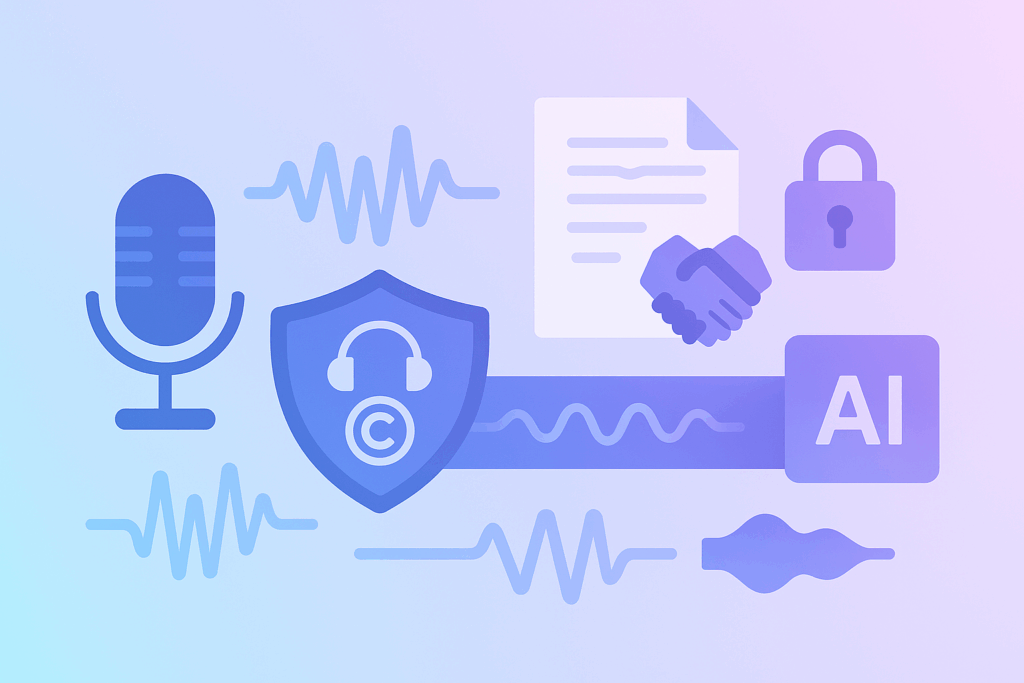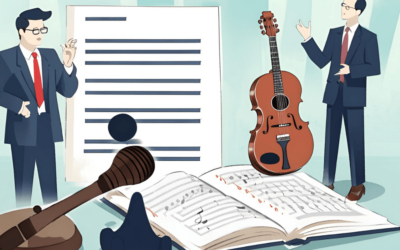Le clonage vocal par intelligence artificielle soulève une question simple : qui contrôle la voix numérisée d’un artiste ? Derrière cette curiosité technologique se cachent des enjeux cruciaux de propriété intellectuelle, de droits voisins et de consentement. Décryptage d’un paysage juridique en pleine mutation.
1. Le clonage vocal : quand la technologie reproduit une prestation artistique
Le clonage vocal par intelligence artificielle consiste à entraîner un modèle sur des enregistrements authentiques pour générer de nouvelles phrases qui imitent timbre, rythme et intonation. Contrairement au simple montage audio, l’algorithme recrée une performance — même si l’artiste n’a jamais prononcé les mots.
Cette « interprétation synthétique » touche le domaine des droits voisins : la voix fait partie intégrante de la personnalité de l’artiste-interprète, protégée en France par l’article L 212‑1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Œuvre, prestation et identité s’entremêlent. Dès qu’un fragment vocal sert à entraîner un clone, on exploite la fixation d’une prestation, donc un droit patrimonial du titulaire. Or, le régime des droits voisins applique les mêmes principes qu’enregistrement traditionnel : autorisation préalable et rémunération équitable.
L’argument selon lequel « l’IA a créé seule » ne tient pas. Juridiquement, le clone dérive d’une captation initiale manifestement humaine. La jurisprudence française protège déjà la voix contre les usages non consentis, qu’il s’agisse de doublage, deepfake ou spot publicitaire, car la prestation conserve son ancrage dans la personne à l’origine du signal sonore.
2. Droits voisins : la voix et le clonage vocal au cœur de la réforme SREN
La loi « SREN » du 21 mars 2024, adoptée pour encadrer les deepfakes, renforce les droits voisins voix. Son article 15 oblige tout fournisseur d’IA générative à documenter l’origine des contenus d’entraînement et, surtout, à attester que l’artiste-interprète a donné un consentement explicite et traçable. À défaut, l’éditeur s’expose à une astreinte civile et pénale dédiée.
Sur le plan européen, le futur AI Act laisse aux États membres le soin de préserver le patrimoine culturel ; la France a donc pris les devants avec SREN. Le texte crée aussi un mécanisme d’injonction rapide devant le tribunal judiciaire compétent. En effet, le juge peut ordonner le retrait en 48 heures d’une séquence clonée illicite. Les sociétés de perception, comme l’Adami, disposent d’un mandat légal pour agir collectivement, simplifiant la défense des droits.
En pratique, la loi SREN consacre la voix comme un « bien immatériel protégé », alignant enfin le régime français sur celui, déjà rigoureux, du droit à l’image des personnes physiques.
3. Le consentement : négocier, prouver, encadrer
Le consentement n’est pas une simple clause standard. Il doit être spécifique, éclairé et distinct de l’autorisation de diffusion classique.
- Première exigence : l’artiste doit connaître la portée technique du clonage (durée, domaines d’exploitation, pays, formats).
- Ensuite, le contrat doit fixer un partage de valeur adéquat : licence exclusive ou non, rémunération fixe plus pourcentage, voire redevance indexée sur l’usage du modèle.
- Enfin, la prudence impose une clause dite « kill‑switch ». Ainsi, l’artiste peut révoquer son autorisation si le clone nuit à sa réputation ou masque sa véritable création. Le droit moral français appuie cette révocabilité. En effet, l’article L 121‑1 CPI permet déjà de s’opposer à toute modification dénaturant l’esprit de la prestation.
Pour se protéger, l’entrepreneur qui commande un clone vocal doit conserver la « preuve numérique » — horodatage, signature électronique, métadonnées — attestant que le consentement a été recueilli avant l’entraînement. Sans ce faisceau, la charge de la preuve basculera en sa défaveur.
4. En cas de clonage non autorisé : quels risques ?
Civilement, l’artiste peut réclamer la cessation de l’exploitation, la destruction des fichiers d’entraînement et des dommages et intérêts couvrant perte d’exploitation et atteinte à la personne.
Pénalement, l’article 335‑4 CPI punit l’atteinte aux droits voisins de trois ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende, alourdie à cinq ans lorsque l’infraction est commise en bande organisée via une plateforme de deepfakes.
À l’international, le « No AI FRAUD Act » déposé au Congrès américain en 2024 prévoit un droit de retrait similaire. Il renforce la coopération transfrontalière, essentielle lorsque des serveurs à l’étranger diffusent un clone illicite. De son côté, la Federal Trade Commission (FTC) a lancé le « Voice Cloning Challenge » pour développer des dispositifs de détection et alerter les consommateurs. Ces initiatives augmentent la probabilité de sanctions si l’entreprise néglige l’audit préalable.
Enfin, n’oublions pas la CNIL : dès qu’un clone vocal contient des données biométriques, le traitement tombe sous le RGPD. À défaut de base légale solide, l’éditeur s’expose à une amende administrative montant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial.
Conclusion
Le clonage vocal IA n’est pas un simple gadget sonore : il mobilise tout l’arsenal des droits voisins et réaffirme la nécessité d’un consentement solide. Avant d’entraîner un modèle, vérifiez la titularité de la prestation, négociez une licence claire et prévoyez des garde‑fous contractuels. En cas de doute, abstenez‑vous : le coût d’un litige dépasse largement le gain d’une voix synthétique.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans la négociation de licences vocales, la rédaction de clauses de consentement adaptées et la défense de vos droits voisins face aux clones numériques.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle, art. L 212‑1 à L 212‑3 et L 335‑4
- Loi n° n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique
- Federal Trade Commission, « Voice Cloning Challenge »
- Deshoulières Av£ocats, « Droit de la musique : nos conseils pour rédiger vos contrats et vous défendre en justice »