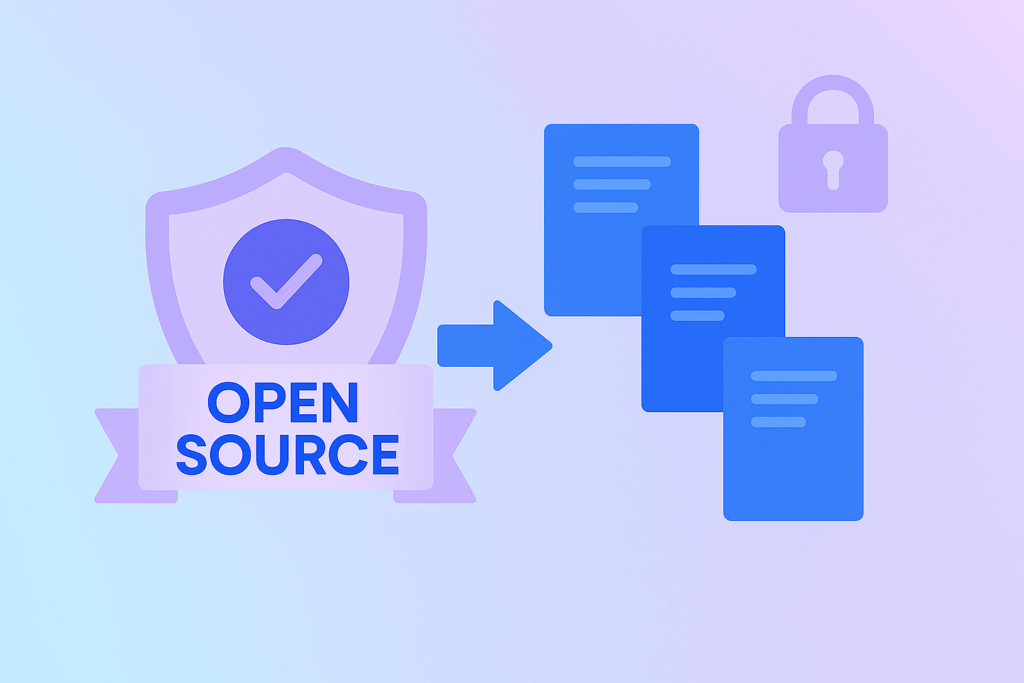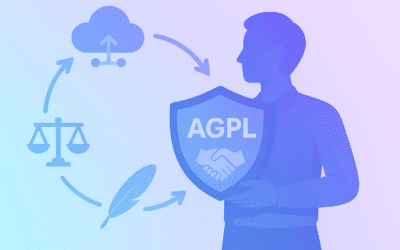La réutilisation de briques logicielles libres est devenue une pratique majoritaire dans les projets tech. Pourtant, mal choisir sa licence ou ignorer ses obligations expose l’entreprise à des risques de contrefaçon et de blocage commercial. Cet article vous explique comment sélectionner, combiner et respecter les licences open source afin de transformer la liberté des licences open source en avantage compétitif.
Choisir sa licence libre : une décision stratégique autant que juridique
Adopter « la » bonne licence n’est pas un geste administratif ; c’est un choix de positionnement. D’abord, définissez vos objectifs.
- Chercher une large communauté avec une licence qui permet d’utiliser, modifier, intégrer et redistribuer le code, sans obligation de publier vos modifications ni d’ouvrir l’ensemble de votre produit final (Apache 2.0 ou MIT),
- Préserver un effet « copyleft ». Dès qu’un développeur intègre tout ou partie d’un code protégé par copyleft dans son propre projet, il doit publier l’ensemble de ce projet sous la même licence lorsqu’il le distribue. L’effet copyleft permet éviter l’appropriation fermée (GPL v3),
- Ou mixer les deux approches par une double‐licence permissive/copyleft (MPL 2.0 + GPL).
Examinez ensuite les points-clés :
-
Étendue des droits cédés : modification, distribution, usage SaaS (« Software as a Service », mode d’exploitation où l’éditeur héberge l’application sur ses propres serveurs et permet aux utilisateurs d’y accéder à distance, généralement par un simple navigateur web, sans nécessité d’en faire une copie).
-
Obligations déclenchées : mise à disposition du code source, mention de paternité, maintien de la licence d’origine.
-
Compatibilité en amont : vos dépendances sont-elles sous une licence qui impose déjà ses propres contraintes ?
Enfin, formalisez ce choix dans un « cahier des charges licences » pour éviter un revirement ultérieur difficile, puisque toute nouvelle contribution sera protégée par la licence initiale et nécessitera l’accord de ses auteurs pour être changée.
Anticiper la compatibilité : l’art d’assembler plusieurs licences
Un projet moderne agrège des dizaines de composants. Chaque ajout doit respecter l’ensemble des licences déjà présentes ; il ne s’agit pas de remplacer une licence, mais d’en ajouter une « au surplus ». Pour vérifier la compatibilité :
-
Identifiez si les licences appartiennent à la même « famille » (GPL, CeCILL, OSL…).
-
Recherchez une clause de compatibilité expresse. A défaut, appliquez la théorie des ensembles : la licence B est compatible si ses obligations sont comprises dans celles de la licence A.
En cas d’incompatibilité, envisagez : une exception (clause de copyleft allégée) ; la multilicence, qui laisse le licencié choisir la licence la plus adaptée ; ou, plus radical, la réécriture du composant concerné. Le raisonnement doit être documenté pour prouver, en cas d’audit, que l’entreprise a exercé une diligence raisonnable.
Respecter le formalisme : code source, attribution et traçabilité
Les libertés offertes par la licence sont conditionnées au respect strict de son mode d’emploi. Concrètement, l’entreprise doit :
-
Distribuer le code source ou un lien pérenne vers celui-ci (art. L.122-7 du Code de la Propriété intellectuelle).
-
Conserver les notices d’origine et faire figurer les auteurs initiaux, conformément au droit moral français.
-
Distinguer ses propres modifications pour éviter la confusion entre code interne et code tiers.
-
Tracer les dépendances dans un registre SBOM (Software Bill of Materials) mis à jour à chaque build.
Sans cette hygiène documentaire, un audit de conformité – fréquent lors d’une levée de fonds ou d’une fusion-acquisition – peut retarder l’opération, voire conduire à une injonction de retrait du marché.
Gouvernance open source : mettre en place des réflexes durables
La conformité ne doit pas dépendre de la seule équipe juridique. Mettez en place :
-
Une politique Open Source validée par la direction. Elle précise les licences autorisées, la procédure d’introduction d’un nouveau composant et les responsabilités.
-
Un comité de revue impliquant développeurs, juristes et équipes produit. Il valide les licences avant chaque release.
-
Des outils automatisés (analyseurs de dépendances, scanners de licences) intégrés pour détecter une incompatibilité.
-
Un programme de formation pour rappeler, par exemple, que l’œuvre d’un mineur ou d’un prestataire extérieur nécessite la double signature auteur/représentant ou une cession écrite avant toute mise en ligne.
Ainsi, vous transformez la contrainte juridique en levier de réputation : la communauté contribue plus volontiers à un projet où la gouvernance est claire.
Conclusion
Sélectionner la licence adaptée, vérifier sa compatibilité, respecter son formalisme et instaurer une gouvernance claire : ces quatre étapes garantissent que votre projet open source reste un atout et non une faille. En cas de doute, anticipez : un audit préventif coûte toujours moins cher qu’une action en contrefaçon. Mettez la question des licences à l’agenda de vos réunions d’architecture et documentez chaque décision. Vous gagnerez en sécurité, en vélocité et en crédibilité auprès de vos partenaires et investisseurs.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne, de l’audit de vos composants open source à la négociation de licences sur mesure, afin de sécuriser vos innovations et d’optimiser votre stratégie de conformité.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle : art. L.112-1 et L.122-7.
- CJUE, 2 mai 2012, SAS Institute v WPL.
- Blog Deshoulières Avocats, « Comment un logiciel est-il protégé par la propriété intellectuelle ? ».