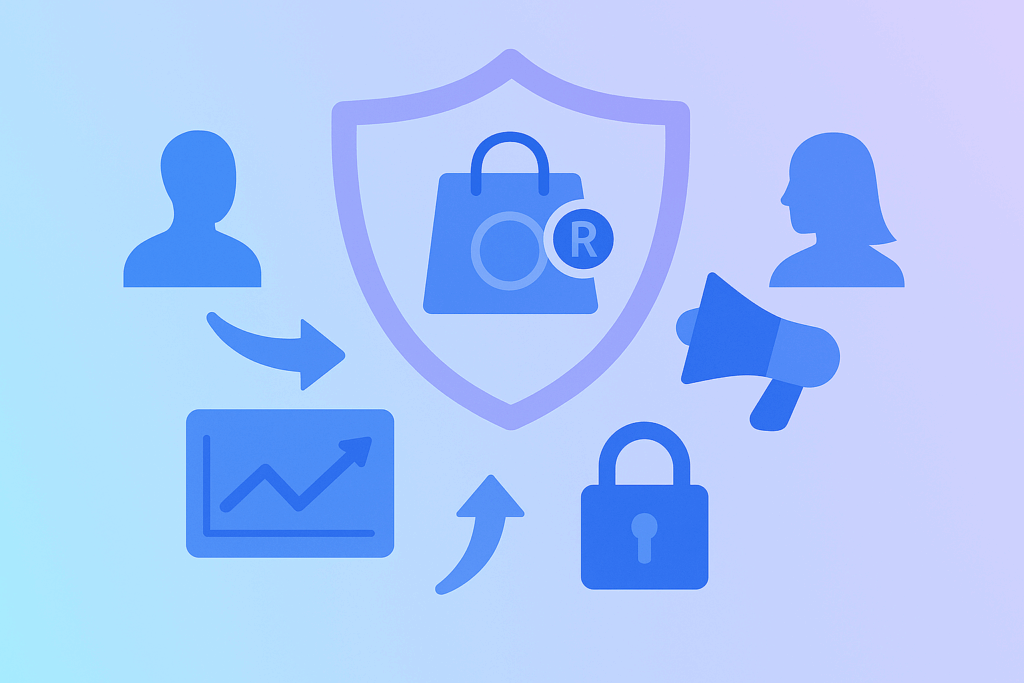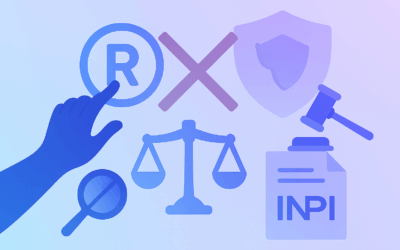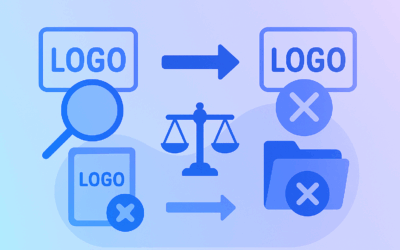Une marque n’est pas qu’un nom ou un dessin. Elle oriente le choix des consommateurs, soutient la réputation d’une entreprise et structure sa stratégie commerciale. Protéger cet atout, c’est donc protéger son marché. Encore faut-il savoir quand le droit intervient, quelles fonctions la loi défend et comment réagir en cas d’atteinte.
- D’abord, la marque garantit l’origine des produits : elle permet d’identifier une entreprise et d’en attendre la même qualité. Cette fonction essentielle, consacrée dès les arrêts Terrapin et Hag II, reste le socle du droit des marques.
- Ensuite, la Cour de justice a reconnu d’autres rôles : communiquer l’image du produit, investir pour bâtir une réputation et soutenir la publicité.
Ces facettes se croisent mais leur protection varie. En présence d’un signe strictement identique pour des biens identiques — la “double identité” — le titulaire peut agir sans prouver de confusion ; il suffit de montrer que l’usage porte atteinte à l’une quelconque de ces fonctions. Dans les cas de simple similitude, la loi exige un risque de confusion dans l’esprit du public. Cette nuance explique pourquoi certaines affaires tournent autour d’une question apparemment simple : le consommateur comprend-il qui est derrière le produit ? Si la réponse devient incertaine, la contrefaçon menace.
2) Double identité, similitude et risque de confusion
Vient la mécanique juridique. Le Code de la propriété intellectuelle transpose la directive 2015/2436 et distingue deux régimes. En double identité, le titulaire n’a qu’à établir quatre éléments :
- usage dans la vie des affaires,
- absence de consentement,
- produits identiques,
- atteinte à une fonction.
Dans l’affaire Google/AdWords, la Cour a rappelé que l’attaque peut viser la fonction publicitaire, même si l’origine reste claire. Lorsque les biens ou les signes ne sont que similaires, le critère clé devient le risque de confusion. Les juges français y reviennent souvent ; ils vérifient la perception d’un consommateur moyen, raisonnablement attentif. Ainsi, l’arrêt Tariquet de 2024 sanctionne la mention “assimilé Tariquet” : l’expression faisait croire à une filiation commerciale qui n’existait pas.
À l’inverse, l’affaire Partitio illustre la sévérité de la preuve : une dénomination sociale identique n’est litigieuse que si l’activité réelle recoupe les services visés par la marque. Sans lien économique concret, la contrefaçon échoue.
3) Fonctions de la marque : investissement et publicité, un terrain d’innovation
Cependant, toutes les atteintes ne brouillent pas l’origine. La reproduction d’une marque de luxe dans un tableau de concordance ou sur un parfum d’imitation peut éroder le prestige de l’original, donc sa capacité à investir. L’arrêt L’Oréal c/ Bellure l’a montré : même sans confusion, la référence systématique à un parfum renommé profite indûment de son aura et nuit à sa valeur publicitaire. De même, deux bières “Budweiser” coexistant dans l’Union ne trompent pas toujours le goût des consommateurs, mais compliquent les campagnes de communication de chaque brasseur.
Les tribunaux français intègrent désormais ces analyses. La cour d’appel de Paris a rappelé, dans l’affaire PSG contre des sites de paris, que la fonction publicitaire n’est pas touchée quand la marque désigne seulement l’équipe sportive objet du pari. Les juges examinent donc le contexte exact de l’usage : support, placement, visibilité de la véritable marque de l’opérateur.
4) Usage ornemental ou descriptif : tout n’est pas contrefaçon
Enfin, beaucoup de litiges naissent d’un réflexe exagéré : poursuivre dès qu’un mot protégé apparaît. Or le droit exige un usage “à titre de marque”. Un slogan, un titre de livre ou l’évocation d’un site touristique n’entrent pas toujours dans le champ de la contrefaçon. La jurisprudence Moulin Rouge illustre bien ce point : la mention du cabaret sur des souvenirs vise à décorer l’objet, pas à indiquer son fabricant. La Cour de cassation confirme régulièrement cette ligne ; elle refuse la sanction quand le signe incriminé perd son pouvoir distinctif au profit de la marque principale de l’annonceur.
En revanche, si l’expression protégée domine l’étiquette ou se combine de façon indissociable à la marque secondaire, le public peut croire à une origine commune ; l’atteinte redevient plausible. La clé réside donc dans la perception globale : l’acheteur moyen voit-il un simple motif décoratif ou un indice d’origine ?
Conclusion
En pratique, protégez votre marque avant que le litige n’éclate. Surveillez les usages en ligne, vérifiez les dépôts voisins et réagissez vite. En cas de doute, analysez d’abord la fonction menacée : origine, qualité, publicité ou investissement. Cette démarche structurée renforce vos arguments et évite les actions inutiles.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous ccompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015
- CJUE, 22 septembre 2011, Interflora, aff. C-323/09
- CJUE, 18 juin 2009, L’Oréal c/ Bellure, aff. C-487/07
- Code de la propriété intellectuelle, articles L. 713-2 et L. 713-3
- Article “Agir en contrefaçon de marque” (blog Deshoulières Avocats)