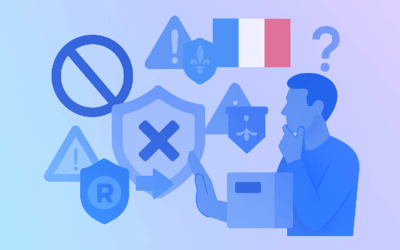Les indications géographiques (IG) jouent un rôle clé dans la valorisation des produits liés à un terroir. Depuis 2019, leur statut dans le droit des marques a été renforcé. Une marque peut être refusée ou annulée si elle porte atteinte à une IG enregistrée. Comment fonctionne cette protection ? Quels sont les critères d’antériorité et d’évocation ? Quelles conséquences pour les titulaires de marques ? Cet article fait le point sur l’articulation entre marques et indications géographiques.
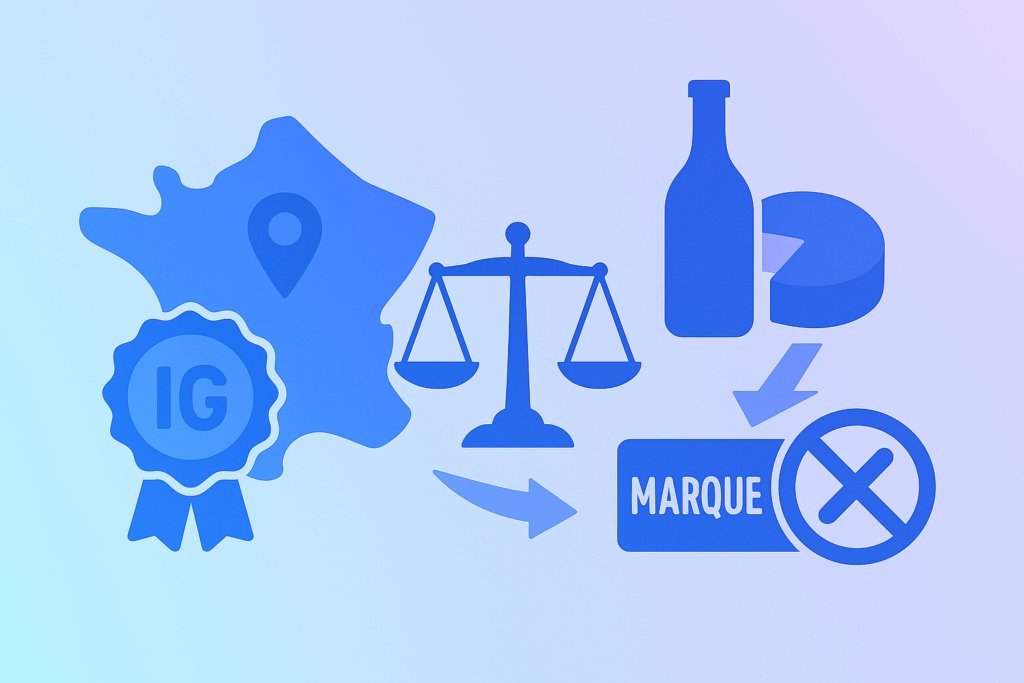
1) Une protection renforcée pour les produits liés à un territoire
Depuis 2019, les indications géographiques bénéficient d’un cadre plus solide dans le droit des marques. Grâce à l’ordonnance n° 2019-1169, qui transpose la directive (UE) 2015/2436, le Code de la propriété intellectuelle interdit désormais l’enregistrement de toute marque qui porterait atteinte à une IG enregistrée. Ce renforcement reflète une volonté européenne de mieux défendre les produits liés à un savoir-faire local ou à une origine géographique précise.
Avant cette réforme, la protection restait limitée. Les autorités pouvaient refuser une marque uniquement si elle entrait en conflit avec une appellation d’origine reconnue. Désormais, même une IG en cours d’homologation peut bloquer un dépôt ultérieur. Cette évolution marque un tournant important.
Elle concerne aussi bien les IG déposées auprès de l’INPI pour des produits artisanaux ou industriels, que les AOP et IGP enregistrées à l’échelle européenne. Elle s’étend également aux dénominations reconnues dans des traités internationaux comme l’Arrangement de Lisbonne ou son Acte de Genève.
2) Des catégories d’IG élargies et mieux définies
Le Code de la propriété intellectuelle rassemble aujourd’hui plusieurs types d’indications géographiques. Cette clarification permet aux acteurs économiques d’identifier plus facilement les droits en présence.
D’abord, les appellations d’origine relevant du Code de la consommation désignent des produits dont les qualités reposent sur un environnement géographique et un savoir-faire local. On distingue notamment :
- les AOC (Appellations d’origine contrôlée), réservées aux produits agricoles ou alimentaires comme les vins, fromages ou huiles ;
- les appellations dites simples, qui couvrent aussi des produits industriels. Ces dernières peuvent être reconnues soit par une autorité administrative, soit par un juge.
Ensuite, la loi du 17 mars 2014 a introduit les IG artisanales et industrielles. Elles visent des objets non alimentaires, tels que la porcelaine ou le mobilier, dont la réputation s’attache à un lieu précis. Pour être reconnues, elles doivent faire l’objet d’un cahier des charges validé par l’INPI.
Enfin, les IG européennes comme les AOP, IGP ou celles concernant les spiritueux s’appuient sur des règlements spécifiques. Par exemple, une IGP suffit si une seule étape de production se déroule dans la zone géographique définie. En revanche, l’AOP exige que toutes les étapes – production, transformation, élaboration – aient lieu sur le territoire concerné.
Par ailleurs, grâce aux accords internationaux, la France reconnaît aussi certaines IG étrangères. L’Union européenne étant partie à l’Arrangement de Lisbonne et à l’Acte de Genève, elle facilite la reconnaissance mutuelle de ces indications au sein de l’espace international.
3) Antériorité des IG : un filtre décisif lors du dépôt de marque
Pour bloquer une marque, une IG doit exister avant le dépôt du signe contesté. Cette antériorité joue un rôle crucial. Elle s’apprécie à la date de dépôt de la demande d’homologation de l’IG ou, si elle n’existe pas, à la date de son enregistrement officiel.
Autrement dit, une IG en cours de validation peut suffire à empêcher le dépôt d’une marque postérieure, à condition que l’IG soit effectivement enregistrée par la suite. Le titulaire de l’IG ou son organisme de gestion peut alors s’opposer à la marque, même si celle-ci désigne des produits différents.
Ce principe a été confirmé par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Bavaria (CJUE, aff. C-120/08). Dans cette décision, la Cour a annulé une marque déposée entre la demande et l’enregistrement d’une IGP. La protection débute donc dès le dépôt de l’IG, et non à sa publication.
Ainsi, les marques postérieures sont directement menacées dès qu’une indication géographique existe, même à l’état de projet. Cette règle donne une force préventive importante aux IG, qui s’imposent comme de véritables antériorités opposables.
4) L’atteinte à une IG : une notion élargie pour mieux prévenir les abus
Une marque ne peut pas profiter indûment de la notoriété d’une IG. En effet, le droit européen et français visent à interdire toute pratique commerciale trompeuse, directe ou indirecte.
Plusieurs comportements peuvent entraîner l’annulation d’une marque. C’est le cas lorsqu’elle :
- évoque une IG sans autorisation,
- imite ou usurpe l’indication,
- exploite sa réputation sans lien réel avec le territoire concerné,
- utilise des expressions du type « genre », « style », « façon »,
- souvent utilisées pour tromper,
- ou encore intègre des visuels,
- symboles ou étiquettes suggérant l’origine protégée.
La jurisprudence européenne s’est montrée très stricte. Dans plusieurs décisions, la CJUE a sanctionné des marques évoquant des IG, même sans risque de confusion pour le consommateur. Il suffit que le public associe mentalement le signe à une IG pour qu’il y ait évocation interdite.
Par exemple :
- « Cambozola » a été jugé évocateur de « Gorgonzola » ;
- « Verlados » rappelait le « Calvados » ;
- « Glen Buchenbach » évoquait le whisky écossais, bien que produit en Allemagne.
Même un simple visuel peut déclencher cette protection. En 2019, la Cour a jugé que des motifs figuratifs sur un emballage évoquaient l’IG « Queso Manchego », bien que le nom ne soit pas utilisé (CJUE, 2019, affaire C-614/17).
Enfin, cette protection s’applique aussi aux services. Si une entreprise nomme son établissement « Champanillo » sans lien avec le champagne, elle enfreint les règles. C’est ce qu’a rappelé la CJUE dans l’arrêt « Champanillo » (CJUE, aff. C-783/19).
En somme, toute tentative de profiter du prestige d’une IG, même de manière subtile, peut être sanctionnée.
5) Marque et IG : une coexistence possible mais risquée
En principe, rien n’empêche d’inclure une IG dans une marque, à condition de respecter certaines règles. Par exemple, un viticulteur peut déposer la marque « Domaine Martin – Saint-Émilion », s’il respecte les conditions d’usage de l’appellation.
Cependant, cette stratégie comporte des risques. Une marque intégrant une IG n’accorde aucun monopole sur cette indication. Si le producteur perd le droit d’utiliser l’IG – faute de respecter le cahier des charges ou à la suite d’un retrait d’agrément – la marque devient immédiatement trompeuse. Elle peut donc être frappée de nullité ou de déchéance.
De plus, les logiques juridiques sont différentes. Une marque est un droit privatif stable, qui confère un monopole. À l’inverse, une IG suppose une conformité continue à un cahier des charges strict, avec des contrôles réguliers. Le moindre écart peut faire perdre le droit d’usage.
C’est pourquoi il reste préférable, dans la plupart des cas, de séparer l’IG de la marque. L’indication géographique suffit généralement à valoriser un produit, sans besoin d’en faire un élément de la marque. Cela évite les confusions et réduit le risque de litige.
Conclusion
L’extension du motif d’opposition fondé sur les indications géographiques offre un outil puissant aux producteurs attachés à leur territoire. Grâce à cette réforme, il devient presque impossible de détourner la notoriété d’une IG à travers une marque commerciale.
Pour autant, cette nouvelle protection impose une vigilance accrue. Avant tout dépôt, il faut examiner soigneusement les IG existantes ou en cours d’enregistrement. L’usage d’un nom évocateur, d’une image symbolique ou d’un qualificatif trompeur peut suffire à faire rejeter une marque.
Enfin, les producteurs bénéficiant d’une IG doivent préserver leur droit d’usage. Ils doivent rester en conformité avec leur cahier des charges et anticiper les conséquences d’un éventuel retrait. Car si l’IG tombe, la marque construite autour peut s’effondrer avec elle.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :