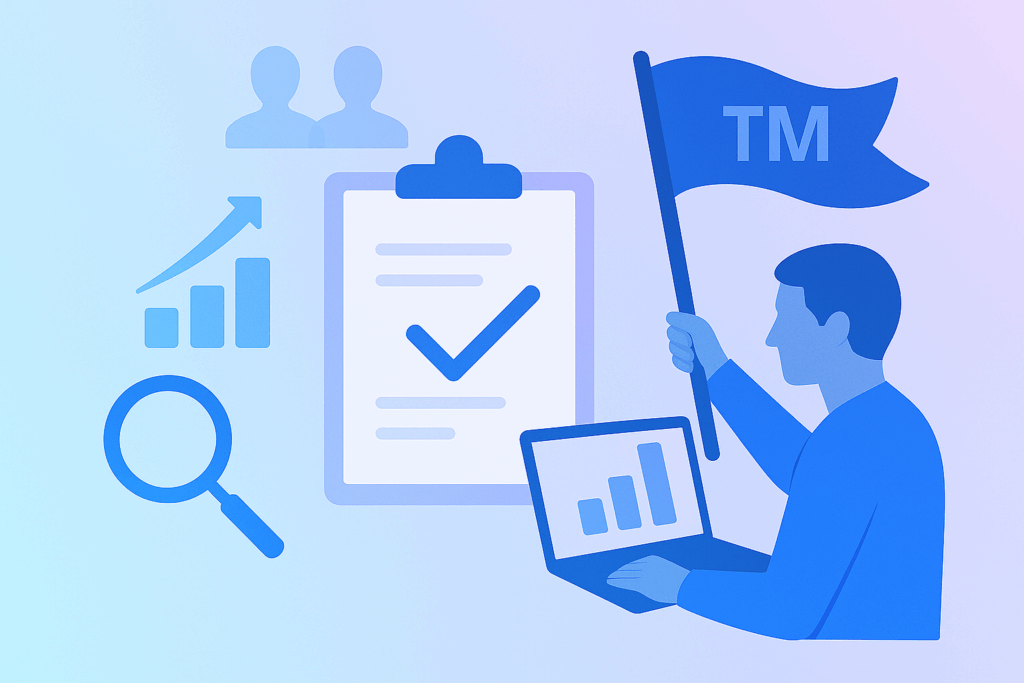Déposer un signe, c’est planter un drapeau. Mais seul l’usage sérieux maintient ce drapeau hissé. Sans preuves tangibles, la marque s’éteint, même si elle est célèbre. Découvrez qui doit utiliser le signe, comment, à quelle intensité et pourquoi certains usages restent invisibles aux juges.
1) Qui peut – vraiment – exploiter la marque ?
Le premier auteur d’un usage sérieux de la marque est le titulaire lui‑même. Qu’il soit artisan individuel ou géant international, il doit apposer la marque sur les produits ou services visés.
Cependant, la loi admet l’usage « avec le consentement du titulaire » : licencié, distributeur, filiale ou même association partenaire. Le point clé : la volonté claire du propriétaire. Un contrat écrit aide, mais une autorisation tacite prouvée par des actes positifs suffit. À l’inverse, une simple tolérance ne protège pas. Le licencié doit aussi commercialiser effectivement ; un contrat dormant ne sauve pas la marque.
Enfin, pour les marques collectives ou de garantie, l’usage par les membres habilités bénéficie à la collectivité, à condition de respecter le règlement d’usage.
2) Quel usage répond à la fonction de marque ?
L’usage sérieux de la marque n’est pas un geste symbolique. Il doit garantir l’origine commerciale du produit, et non servir d’ornement ou de slogan vague. Apposer le signe comme enseigne, nom de domaine ou titre d’œuvre ne suffit que si le consommateur l’identifie comme indicateur d’origine.
Les juges écartent ainsi l’usage purement publicitaire, l’apposition sur des goodies gratuits ou les simples annonces presse dépourvues de mise sur le marché.
À l’inverse, un usage « ombrelle » – la marque‑parapluie qui coiffe une gamme – reste valable ; le signe guide le public vers une famille de produits et remplit sa fonction.
3) Quelle intensité faut‑il atteindre pour un usage sérieux de la marque ?
La Cour de justice rejette toute règle de minimis : un chiffre magique n’existe pas. Elle analyse « l’ensemble des circonstances » : volume, fréquence, durée, parts de marché, nature du secteur. Vendre cent valises de luxe par an peut suffire ; écouler dix mille canettes dans toute l’UE peut échouer.
Les juges valorisent la régularité plus que le pic isolé : mieux vaut mille unités chaque année que cinq mille d’un coup. Ils tolèrent aussi l’usage modeste si le marché est étroit ou si la relance est entravée (perte d’agrément, conjoncture).
Mais l’usage sporadique, ponctuel ou interne – un seul client, une facture-test, des prototypes – tombe. Même le fabricant de pièces détachées doit montrer que le signe rejoint le public, pas seulement l’atelier.
4) Actes préparatoires : peuvent‑ils sauver la marque ?
En principe non : la marque doit déjà toucher le marché. Pourtant la Cour admet des préparatifs « imminents » – tests consommateurs, campagnes presse lancées, stocks prêts – si l’entrée en vente est certaine. Mais attention : une relance dans les trois mois avant la demande de déchéance est inopérante si le titulaire savait l’attaque imminente.
Quant aux produits anciens, l’entretien et la vente de pièces détachées sous la même marque maintiennent aussi les droits sur le produit initial ; l’usage après‑vente suffit, car il rassure toujours le consommateur sur l’origine.
Conclusion
L’usage sérieux est la sève de la marque. Il exige un exploitant autorisé, une apposition lisible pour le public et une présence régulière sur le marché ciblé. Préparez un dossier de preuves : factures, photos, publicités ciblées, rapports de vente. Sans elles, cinq ans d’inaction suffisent à déraciner le titre.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714‑5 et L. 716‑3
- CJUE, 11 mars 2003, aff. C‑40/01 (Ansul)
- CJUE, 15 janv. 2009, aff. C‑495/07 (Silberquelle)
- Cass. com., 30 nov. 2004, n° 02‑18.731
- CJUE, 22 oct. 2020, aff. C‑720/18 et C‑721/18 (Ferrari)
- Deshoulières Avocats, « Répondre à une opposition de marque«