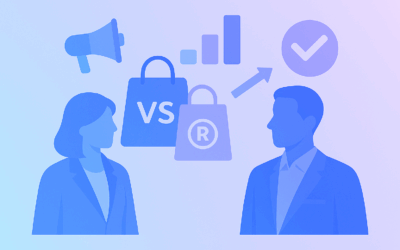La Cour d’appel de Paris a condamné, le 7 mai 2025, la société Forseti – éditrice de la plateforme doctrine.fr – pour concurrence déloyale et publicité comparative mensongère. En cause : la collecte massive et non autorisée de centaines de milliers de décisions de justice, intervenues avant l’entrée en vigueur de l’open data judiciaire, et une communication commerciale jugée trompeuse. Retour sur un arrêt qui rappelle aux legaltech que, même à l’ère du numérique, les principes de loyauté et de protection des données personnelles demeurent incontournables.

1. Une moisson de décisions “sauvage” qui fausse la concurrence
Entre 2016 et 2019, Doctrine s’est constitué un fonds jurisprudentiel record (près de dix millions de décisions) en s’approvisionnant directement auprès des greffes judiciaires, administratifs et commerciaux – sans autorisations écrites ni convention formelle, contrairement à ses rivaux Dalloz, Lexbase ou LexisNexis. Pour les juges, les preuves convergent : cette captation illicite viole l’article R. 123-5 du Code de l’organisation judiciaire, lequel impose l’accord du directeur de greffe pour toute réutilisation de décisions, ainsi que l’article 6 de la loi “Informatique et libertés” qui exige un traitement loyal des données à caractère personnel. Résultat : Forseti s’est octroyé “un avantage concurrentiel indu” en proposant plus de contenus que ses compétiteurs, sans supporter les mêmes contraintes ni coûts.
A retenir:
Dans la distribution d’informations juridiques, obtenir un jugement n’est pas libre-service : il faut l’accord du greffe parce que ces documents contiennent des noms et des données sensibles. Doctrine a court-circuité ce filtre, gagnant ainsi un temps et une ampleur que les autres éditeurs, restés dans les clous, ne pouvaient égaler.
2. Pourquoi l’open data ne blanchit pas le passé
Depuis le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, un calendrier progressif prévoit la mise en ligne gratuite des décisions, après anonymisation, avec une première vague à la Cour de cassation en 2021 et un achèvement fin 2024 pour les décisions de première instance ; cette réforme découle de la loi “République numérique” de 2016. Mais la cour rappelle que cette ouverture n’est pas rétroactive : les faits reprochés se situent avant le 31 décembre 2018, à une époque où les décisions relevaient encore d’un circuit contrôlé. Autrement dit, avoir raison trop tôt ne dispense pas de respecter les règles en vigueur au moment des faits.
A retenir:
Le législateur a promis de rendre la justice plus transparente, mais il a fixé un calendrier d’application. Publier avant l’heure, sans filtre, reste interdit ; c’est l’équivalent numérique d’ouvrir la salle des archives au public alors que la clé n’est pas encore distribuée.
3. Typosquatting et publicité comparative : deux fautes d’image
Forseti a également réservé les noms de domaine cassation.fr et conseildetat.fr pour rediriger les internautes vers doctrine.fr. Les juges y voient un “typosquatting” créant la confusion avec les sites officiels des hautes juridictions. Par ailleurs, la plateforme vantait “plus de dix millions de décisions”, chiffre incluant des données collectées illicitement ; cette publicité comparative est jugée mensongère, faute de preuve et de loyauté.
A retenir:
C’est comme s’enregistrer “impots.gouv-service.com” pour attirer l’internaute vers un service privé payant : on profite de la notoriété d’un acteur public pour gagner des clics. De même, se comparer aux concurrents avec des chiffres gonflés par des pratiques irrégulières revient à tricher sur la feuille de match.
4. Leçons à retenir pour les legaltech et les professionnels
Respecter le cadre d’accès aux données
Tant que l’open data n’a pas livré la totalité des décisions, chaque legaltech doit sécuriser ses canaux d’alimentation (conventions, licences, achats auprès d’Infogreffe, etc.) et documenter la traçabilité des données.
Anticiper la protection des données personnelles
Même anonymisées, les décisions restent susceptibles de ré-identification. La CNIL veille : un manquement peut entraîner une amende administrative, en plus du risque civil de concurrence déloyale.
Soigner la communication commerciale
Les comparatifs de volume ou de prix doivent être vérifiables, spécifiques et honnêtes. En B2B comme en B2C, l’allégation trompeuse est sanctionnée.
Maîtriser les noms de domaine et le référencement
Acheter des “keywords” institutionnels peut être légal, mais pas au point de créer la confusion. Les décisions “cassation.fr” et “conseildetat.fr” rappellent que la frontière entre stratégie SEO agressive et dénigrement est mince.
L’arrêt du 7 mai 2025 sonne comme un avertissement : l’innovation ne doit pas rimer avec appropriation sauvage. Tandis que l’open data avance, la décision rappelle qu’une base de données, aussi intelligente soit-elle, doit reposer sur un socle légal solide. Pour les professionnels, c’est l’assurance d’un marché plus transparent et équitable ; pour les utilisateurs finaux, c’est la garantie d’une information fiable et respectueuse des droits. L’aventure legaltech continue, mais le juge veille – et le respect des règles reste la meilleure stratégie de croissance durable.
***
Pour toute demande de conseil juridique, n’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez dès à présent demander un devis gratuit ici.