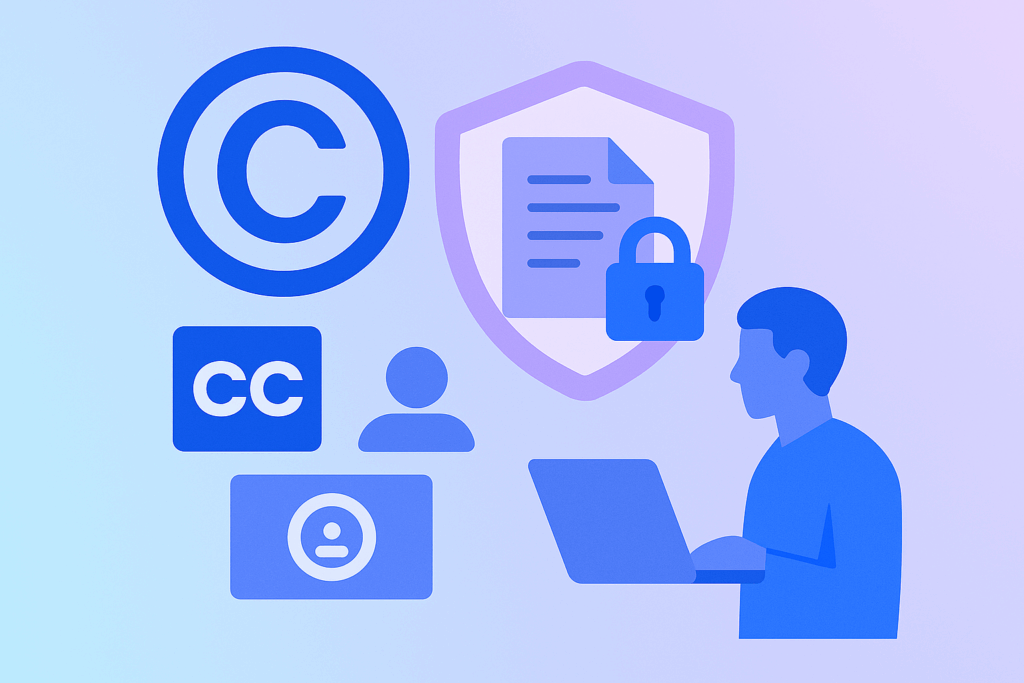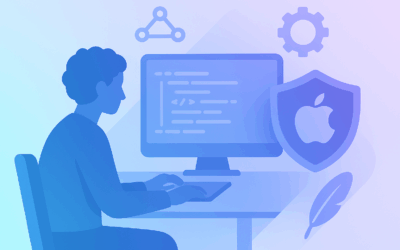Les licences libres séduisent les entreprises, car elles accélèrent l’innovation et réduisent les coûts. Cependant, elles comportent des clauses dangereuses pour vos actifs de propriété intellectuelle. Cet article clarifie les notions juridiques essentielles, montre comment éviter les pièges contractuels et propose une méthode simple pour exploiter un logiciel open source.
1) Comprendre la nature juridique des licences libres
D’abord, une licence libre est avant tout un contrat. Elle organise la cession non exclusive de droits d’auteur au profit de chaque utilisateur.
Cette cession, gratuite mais irrévocable tant que la licence demeure, autorise la copie, la modification et la redistribution de l’œuvre. Ensuite, parce que la licence repose sur la volonté des parties, le juge vérifiera toujours l’intention du titulaire. En cas de litige, le texte original primera sur toute traduction. Cependant, la gratuité de la licence n’interdit pas la vente du support matériel : vous pouvez facturer le service d’installation.
Enfin, retenez que la licence ne supprime jamais les droits moraux de l’auteur. Elle encadre simplement leur exercice pour garantir la liberté de chacun. Vous devez donc conserver les mentions de paternité, diffuser le texte de la licence avec le code source et respecter les conditions spécifiques de chaque clause.
2) Sécuriser la chaîne contractuelle dans vos projets open source
Ensuite, toute intégration d’un module libre crée une chaîne contractuelle. Plus il y a de contributeurs, plus la chaîne se fragmente. Pour limiter le risque, cartographiez vos dépendances, vérifiez la compatibilité des licences et identifiez le titulaire de chaque contribution.
Dans un groupe international, demandez une délégation écrite autorisant vos développeurs à accepter des licences libres pour le compte de la société ; vous éviterez qu’un simple commit engage toute la maison mère. De même, négociez des clauses de rétrocession avec vos sous-traitants : ils doivent garantir qu’ils n’introduisent aucun code incompatible.
Enfin, mettez en place une procédure de revue documentaire. Ainsi, vous pourrez prouver votre diligence et empêcher la rupture de la chaîne en cas de défaillance d’un maillon.
3) Anticiper les risques de responsabilité et de garantie
Cependant, la plupart des licences libres excluent toute garantie expresse ; elles fournissent l’œuvre « en l’état ». Cette clause n’écarte pas la responsabilité pour faute lourde, ni l’obligation d’éviction : vous devez toujours détenir les droits que vous cédez. Si vous distribuez le logiciel à des consommateurs, le droit de la consommation français peut réintroduire des garanties légales. Pour limiter votre exposition, rédigez des conditions générales claires. Rappelez la nature libre du composant, déclinez les garanties commerciales et précisez la loi applicable. Par ailleurs, une mauvaise compatibilité de licences peut constituer une contrefaçon, entraînant saisie et dommages-intérêts.
Enfin, formez vos équipes : un développeur averti repère plus facilement une clause virale et évite l’erreur coûteuse.
4) Gérer l’international : langue, loi applicable et litiges
Les projets open source traversent les frontières. La langue du contrat compte : la version anglaise fait foi, sauf si la licence attribue une valeur égale aux traductions. En France, la loi Toubon impose un support en français lorsqu’une administration ou un consommateur intervient ; fournissez donc un résumé fidèle pour éviter la nullité.
Concernant la loi applicable, la Convention de Rome de 1980 laisse d’abord le choix aux parties ; à défaut, le juge retient le pays présentant les liens les plus étroits. Pour un site français qui télécharge du code publié par un auteur américain, le droit français pourrait s’appliquer si l’usage principal se situe en France. Mieux vaut insérer une clause attributive de compétence et choisir un tribunal rompu au contentieux numérique.
Si un conflit s’annonce, privilégiez la médiation : plusieurs organismes spécialisés, dont la Software Freedom Conservancy, facilitent des accords rapides et confidentiels. Cette approche préserve la relation commerciale et évite une jurisprudence incertaine.
Conclusion
Les licences libres offrent un formidable levier d’innovation, à condition de comprendre leur logique contractuelle, de sécuriser la chaîne de cession, de maîtriser la responsabilité et d’anticiper les enjeux internationaux. Prenez le temps de cartographier vos dépendances et de former vos équipes : vous transformerez un risque en avantage concurrentiel.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos projets open source, en France comme à l’international.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle, art. L.122-7-1 et L.131-3
- Directive UE 2019/790 sur le droit d’auteur
- Article « Action en contrefaçon de logiciel », Deshoulières Avocats