Choisir une licence open source ne relève pas d’un simple détail technique. C’est un acte juridique lourd de conséquences pour la valorisation d’un actif logiciel. La licence European Union Public License (EUPL) v 1.2, seule licence officielle de l’Union européenne, conjugue sécurité juridique, ouverture du code et rayonnement international.
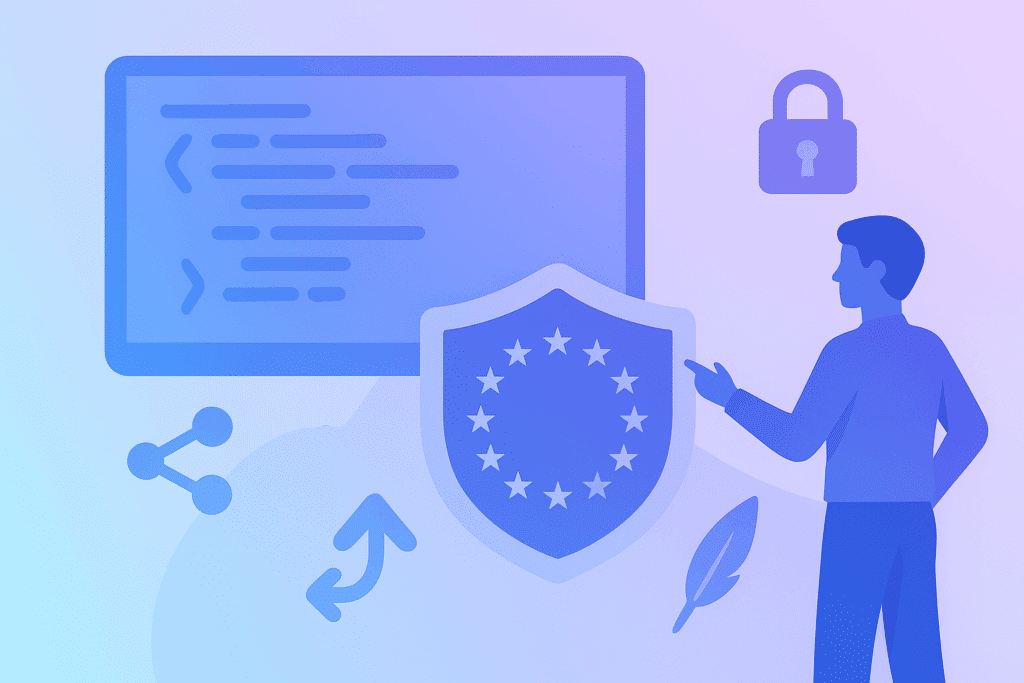
1) À qui s’adresse la licence European Union Public License ?
L’European Union Public License vise d’abord les entités publiques européennes qui souhaitent diffuser leurs développements sans perdre la maîtrise de leurs droits patrimoniaux. Pourtant, son champ ne se limite plus aux administrations. De nombreuses PME innovantes, start-ups SaaS et grands groupes s’en servent pour mutualiser des briques logicielles tout en sécurisant la chaîne de propriété intellectuelle.
En effet, l’EUPL repose sur le droit d’auteur tel qu’harmonisé par la directive 2009/24/CE et transposé en France aux articles L.122-6 et L.122-7 du Code de la propriété intellectuelle. Les bénéficiaires recherchent donc une licence rédigée en termes juridiques disponible dans vingt-trois langues. Son caractère « copyleft » attire également les associations, laboratoires de recherche et consortiums industriels soucieux d’imposer le partage à l’identique des améliorations. Enfin, le texte séduit les entreprises extra-européennes qui traitent avec des institutions de l’UE. Choisir la licence de l’Union leur confère une crédibilité réglementaire tout en rassurant leurs partenaires européens.
2) Comment fonctionne concrètement l’European Union Public License ?
La licence opère comme un contrat cadre. Le concédant autorise l’utilisation, la reproduction, la modification et la distribution du logiciel, sous réserve de conserver l’EUPL sur toute copie ou dérivé. Elle repose sur un mécanisme « copyleft fort ». En effet, toute distribution ou simple mise à disposition au public déclenche l’obligation de republier le code source complet sous EUPL. La clause de brevet, limitée aux revendications nécessaires pour exploiter le logiciel, protège les licenciés contre les poursuites du concédant.
En cas de violation, la résiliation est automatique. Toutefois, un délai de régularisation de trente jours peut être prévu dans la pratique contractuelle pour restaurer les droits.
S’agissant de la loi applicable, l’article 15 désigne celle de l’État membre où le concédant est établi, ce qui assure une cohérence avec le forum compétent. Lorsque le concédant est hors UE, la loi belge s’applique par défaut. Cette solution évite les « forum shopping » et renforce la prévisibilité.
Enfin, la licence autorise la sous-licence automatique. Chaque licencié redevient concédant vis-à-vis des tiers, ce qui garantit une chaîne ininterrompue de droits et d’obligations.
3) Avantages et inconvénients pour votre stratégie en propriété intellectuelle
- Premier atout : l’EUPL offre une sécurité linguistique inégalée. Un chef d’entreprise peut s’appuyer sur la version française ou italienne sans redouter une discordance avec l’original anglais.
- Deuxième avantage : sa compatibilité expresse avec cinq licences majeures (comme GPLv3 ou MPL) facilite l’intégration de composants externes sans conflit de licences.
- Troisième force : la clause de garantie d’éviction oblige chaque contributeur à certifier la titularité de ses droits, réduisant le risque de contrefaçon.
Cependant, le caractère copyleft peut effrayer les investisseurs désireux de garder certaines parties propriétaires. Toute diffusion publique force le retour sous EUPL, ce qui n’est pas le cas avec l’Apache 2.0 ou la BSD. Par ailleurs, le champ mondialement reconnu reste encore moins médiatisé que celui de la GPL. Certains écosystèmes hors Europe peuvent méconnaître ses spécificités, créant un besoin d’acculturation. Enfin, la référence à la loi belge par défaut peut surprendre les acteurs américains qui souhaitent une juridiction plus familière.
4) EUPL, GPL, MIT : quelle licence pour quel usage ?
- Comparée à la GPLv3, l’EUPL impose un copyleft équivalent mais ajoute une traduction officielle multilingue et un choix de loi plus précis. Elle s’intègre donc mieux à des projets institutionnels multinationaux.
- Face à l’MIT ou à l’Apache 2.0, très permissives, l’EUPL se montre plus protectrice pour le concédant, puisqu’elle évite l’appropriation privée du code, au prix d’une possible réticence des intégrateurs propriétaires.
- Par rapport à la CERN OHL v2, dédiée au hardware ouvert, l’EUPL cible le logiciel et ignore les contraintes de conception physique, rendant son périmètre plus clair pour les éditeurs.
Enfin, en matière de compatibilité ascendante, l’EUPL prévoit expressément la re-licence sous certaines licences tierces. La GPL, elle, refuse toute sortie de son périmètre, tandis que l’Apache n’impose aucun retour de code. Ainsi, pour un chef d’entreprise qui souhaite stimuler la collaboration, l’EUPL constitue un compromis équilibré entre ouverture, sécurité et rayonnement international.
Conclusion
L’EUPL combine une architecture copyleft robuste, une portée linguistique unique et un ancrage juridique européen stable. Elle attire les acteurs désireux de partager leurs développements sans renoncer à la maîtrise de leur propriété intellectuelle. Avant de l’adopter, pesez soigneusement l’impact de sa logique de partage obligatoire sur votre modèle d’affaires. Un audit de vos briques logicielles et de vos objectifs de marché s’impose.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne par l’expertise technique et la maîtrise du droit de la propriété intellectuelle pour transformer vos logiciels en levier de croissance durable.
RESSOURCES :
- Directive 2009/24/CE relative à la protection juridique des programmes d’ordinateur.
- Code de la propriété intellectuelle, articles L.122-6 à L.122-7 (droits patrimoniaux).
- CJUE, 2 mai 2012, aff. C-406/10, SAS Institute Inc. c/ World Programming Ltd.
- Deshoulières Avocats – « Licences libres et open source : quelle licence choisir ? », article blog, mise à jour 2025.


