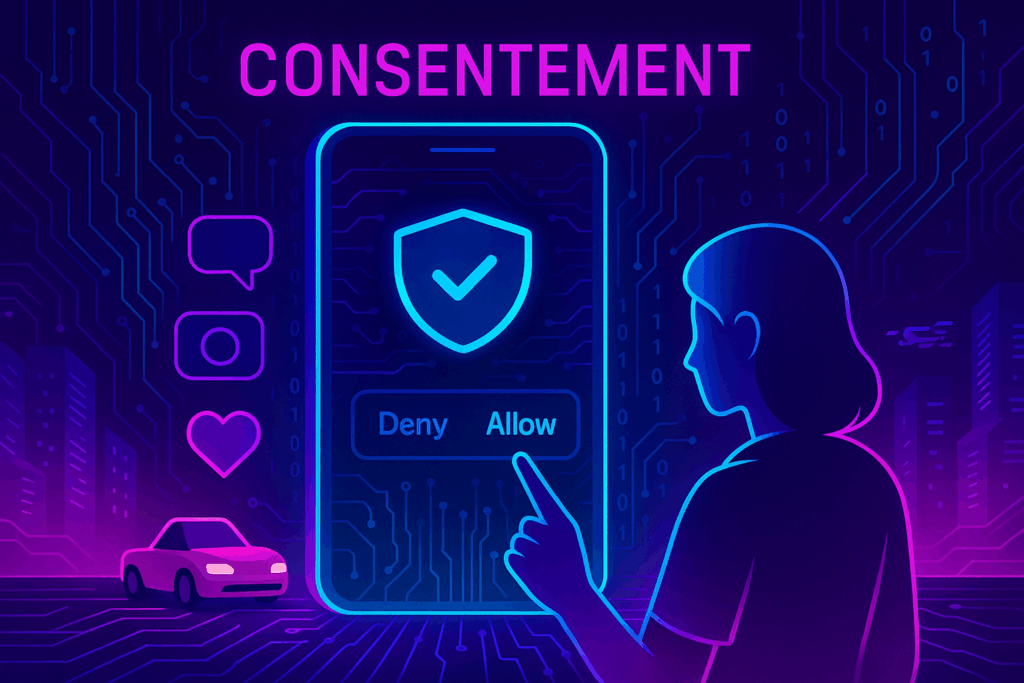Le RGPD ne réclame pas toujours un accord solennel et signé. Dans la plupart des usages courants – cookies, prospection, services pour mineurs –, un consentement standard suffit, à condition d’être libre, spécifique, éclairé et univoque, puis de pouvoir être prouvé.
1) Pourquoi le consentement standard demeure la règle générale
2) Mineurs en ligne : un cadre renforcé mais toujours « standard »
Ensuite, les enfants occupent une place particulière. L’article 8 impose un consentement lorsqu’un service de la société de l’information s’adresse directement à eux. Le règlement fixe l’âge de référence à seize ans, laissant aux États la liberté de descendre jusqu’à treize ans. Le législateur français a opté pour quinze ans et, plus encore, a instauré un double accord : celui du mineur et celui d’au moins un titulaire de l’autorité parentale. Cet « opt‑in conjoint » reconnaît l’autonomie progressive du jeune tout en sécurisant la décision.
Le responsable de traitement doit donc déployer un système de vérification : attestation parentale, e‑mail de confirmation ou contrôle par carte bancaire à zéro euro. Le processus doit rester proportionné ; le RGPD parle d’« obligation de moyens ». Au‑delà de l’âge requis, le mineur signe seul.
Pour les deux publics, la condition clé reste l’information : langage simple, icônes claires, vidéos explicatives si besoin. Sans cette transparence, l’accord se dégrade et l’entreprise s’expose à la CNIL. En pratique, un réseau social qui cible les moins de quinze ans doit prévoir un tableau de bord parental, un bouton de retrait accessible et des alertes pédagogiques.
Cette vigilance transforme le devoir légal en avantage compétitif : les parents préfèrent les plateformes qui protègent vraiment les données personnelles de leurs enfants.
3) Cookies, traceurs et communications : le laboratoire vivant du consentement
Cependant, c’est le cadre ePrivacy qui rend le consentement standard particulièrement visible. Avant qu’un site charge un cookie non essentiel ou installe un traceur publicitaire, il doit d’abord recueillir un accord net. Les régulateurs imposent une règle simple : dès la première visite, deux boutons de même taille, « Tout accepter » et « Tout refuser », doivent s’afficher côte à côte.
Dès lors, faire défiler la page ou continuer à surfer ne vaut plus consentement. Seuls trois types de traceurs échappent à l’opt‑in : ceux qui font tourner le panier d’achat, ceux qui maintiennent la connexion sécurisée et ceux qui mesurent l’audience de façon vraiment anonyme. À la moindre visée marketing, l’autorisation redevient obligatoire. En outre, l’utilisateur doit pouvoir retirer son accord en un seul clic, grâce à une icône ou un lien toujours visible.
Le champ ne se limite pas aux cookies. La directive ePrivacy exige aussi un consentement pour écouter, enregistrer ou analyser une conversation, recycler des données de trafic à des fins commerciales, localiser un terminal ou inscrire un abonné dans un annuaire public.
La prospection par e‑mail suit la même règle : accord préalable, sauf si l’on s’adresse à des clients existants pour des produits semblables. Par conséquent, opérateurs télécoms, éditeurs d’applis et sites marchands doivent instaurer un recueil clair, consigner la preuve et offrir un centre de préférences. Lors d’un contrôle, la CNIL regarde l’horodatage, la version du bandeau et la liste exacte des finalités acceptées. Le coût d’un écart est élevé : un réseau social a reçu 60 millions d’euros d’amende parce qu’il fallait trois clics pour refuser les cookies contre un seul pour les accepter.
4) Conserver et prouver : la gouvernance au cœur du consentement standard
Enfin, la conformité RGPD ne s’arrête pas après le clic. Le responsable de traitement doit prouver, à tout moment, que le consentement existe toujours. Une CMP enregistre la date, l’adresse IP tronquée, la version du bandeau et le choix réel de l’utilisateur. Ces traces suffisent souvent, mais le principe de minimisation reste prioritaire : on ne garde aucun identifiant superflu.
La preuve doit aussi rappeler le contexte : information donnée, finalité annoncée et droit de retrait. Cette documentation enrichit le registre du traitement, tenu par le DPO, et protège l’entreprise lors d’un audit.
La gouvernance suit un cycle de vie précis : expiration automatique des consentements après un délai clair, révision régulière des finalités, mise à jour des notices et tests d’interface. Si l’utilisateur retire son accord, le système efface les données ou les bascule sur une autre base juridique déjà justifiée. Le workflow avertit aussi les sous‑traitants, car l’article 28 leur impose d’agir sans délai. Pour garantir l’alignement, chaque contrat prévoit le rapport des retraits et un droit d’audit. Ce sérieux prouve, en cas de litige, que l’entreprise dépasse la simple formalité et cultive une vraie conformité RGPD.
Le consentement standard n’est donc pas secondaire. Il régit la plupart des traitements quotidiens : cookies, réseaux sociaux, prospection électronique ou services destinés aux mineurs. Pour le rendre valable, vous devez assurer la liberté du choix, la clarté de l’information, la précision des finalités et la traçabilité de la preuve. Installez une CMP lisible, formez vos équipes et testez vos parcours : vous transformerez une obligation légale en avantage concurrentiel.
Deshoulières Avocats vous accompagne pour votre mise en conformité et vos litiges en données personnelles.
RESSOURCES :