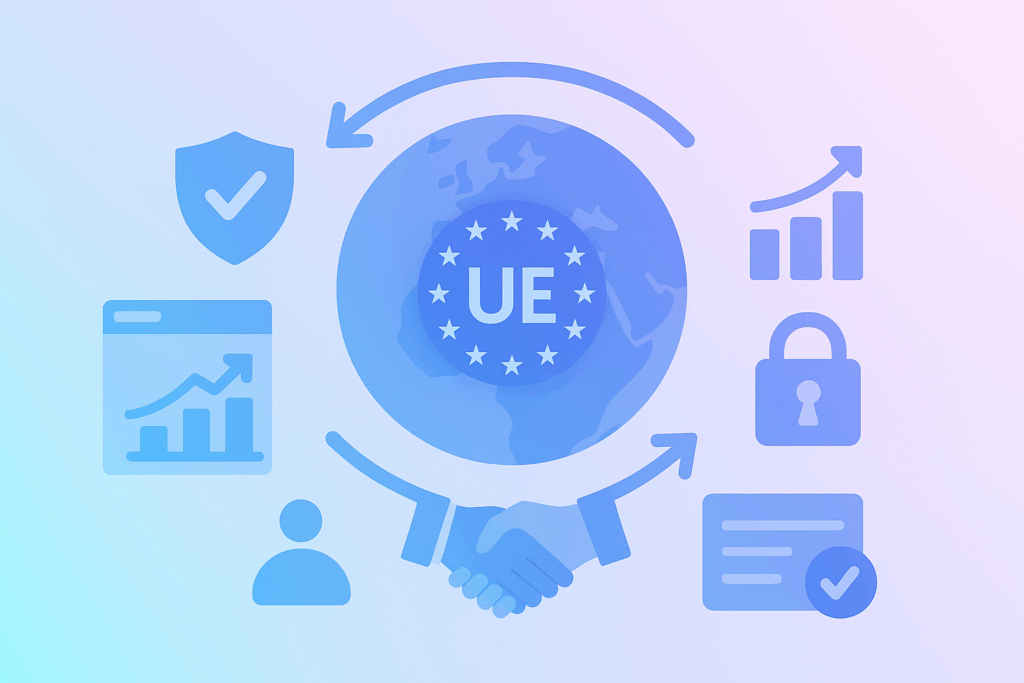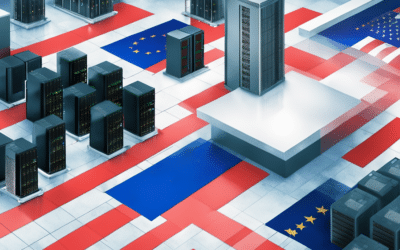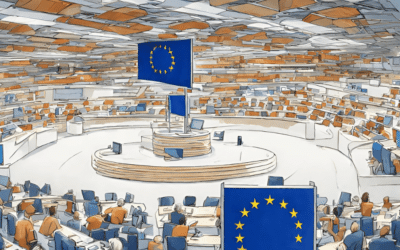Exporter des jeux de données stratégiques vers un tiers pays peut dynamiser un marché, mais expose l’entreprise à la perte de contrôle de ses actifs immatériels. Maîtriser le transfert industriel de données suppose donc d’équilibrer la logique du free flow voulue par Bruxelles et la protection des droits de propriété intellectuelle qui font la valeur de ces données.
1. Le cadre européen : entre liberté de circulation et protection des actifs immatériels
Depuis le Règlement 2018/1807, toute donnée non personnelle doit circuler librement à l’intérieur de l’Union. Le texte interdit les exigences nationales de localisation, sauf motif de sécurité publique. En outre, il oblige les prestataires à prévoir la réversibilité des données.
La future architecture repose à présent sur le Data Act (règlement UE 2023/2854). L’article 5 consacre un droit d’accès direct du client à ses données générées par l’usage d’un produit connecté. L’article 35, lui, encadre la mise à disposition vers des pays tiers, surtout si la législation étrangère impose une divulgation non autorisée. Enfin, il est précisé que l’objectif politique reste de créer un marché unique de la donnée sans sacrifier la souveraineté numérique.
Toutefois, ces règles européennes cohabitent avec la protection des bases de données : la structure originale relève du droit d’auteur, le contenu bénéficie du droit sui generis lorsque l’investissement est substantiel. Les titulaires doivent donc articuler libre circulation interne et verrou contractuel externe.
2. Transférer sans trahir : cartographier les risques vers un tiers pays
Avant tout transfert industriel de données hors UE, l’exportateur doit identifier la nature juridique de chaque fichier : données personnelles protégées par le RGPD, informations couvertes par le secret des affaires, ou éléments d’une base protégée par le droit sui generis.
Ensuite, il vérifie si l’ordre juridique du pays destinataire prévoit un niveau de protection équivalent. À défaut, l’article 35 du Data Act impose des garanties techniques (pseudonymisation, chiffrement asymétrique) et contractuelles (renvoi automatique devant un tribunal européen en cas de demande d’accès étatique). En parallèle, la clause de continuité obligatoire du règlement 2018/1807 interdit de bloquer la réversibilité au seul motif qu’un serveur a quitté l’UE.
Enfin, l’entreprise doit mesurer l’impact concurrentiel. Le transfert peut faciliter une innovation conjointe, mais aussi créer un effet “ascenseur” pour le partenaire étranger qui capte la valeur. Une analyse coûts‑avantages, incluant la durée d’exclusivité et la possibilité de licences croisées, complète le dispositif.
3. Clauses contractuelles et outils techniques : sécuriser le transfert industriel de données
Le contrat reste l’outil-clé.
- Première étape : définir avec précision l’objet du transfert (données brutes, données enrichies ou métadonnées) et la durée d’exploitation. Limiter l’exploitation à un projet identifié réduit le risque de détournement.
- Seconde étape : prévoir des clauses d’extraction contrôlée. L’utilisateur autorisé peut extraire des parties substantielles de la base uniquement pour les besoins décrits, conformément à l’article L. 342‑1 CPI. Toute sous‑licence nécessite l’accord exprès du fournisseur.
- Troisième étape : encadrer la sous‑traitance technique. Le Data Act exige que tout prestataire de traitement respecte le même niveau de sécurité, même hors UE.
- Enfin, insérer une clause de réversibilité complète la conformité. Le destinataire restitue ou efface les jeux de données sous un format structuré et ouvert, sans frais excessifs, dans un délai maximal évoqué par l’annexe du règlement 2018/1807.
Des mesures techniques (on‑premises gateway, chiffrement homomorphique, journalisation inviolable) garantissent la traçabilité et la preuve d’usage conforme.
4. Gouvernance continue : audits, cybersécurité et valorisation
Le transfert n’est pas un acte ponctuel ; il ouvre un cycle de gouvernance. Un audit annuel vérifie le respect des clauses, les journaux d’accès et la localisation effective des données.
En outre, la cybersécurité doit rester proportionnée à la valeur économique de la base : mise à jour des certificats, segmentation réseau, tests de pénétration.
Le Data Act encourage également la valorisation dynamique : l’entreprise peut établir un système de redevances progressives si le partenaire crée de la valeur ajoutée grâce aux données reçues. Ce mécanisme reconnaît la propriété intellectuelle tout en favorisant l’innovation conjointe.
Prévoir une clause de médiation rapide limite les interruptions d’activité lorsque surgissent des litiges transfrontaliers. En back‑office, un registre interne des données exportées facilite la preuve de conformité auprès des autorités de contrôle et rassure les investisseurs.
Conclusion
Le transfert industriel de données hors UE demande donc un véritable équilibre : laisser circuler l’information pour rester compétitif, tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle qui fondent la valeur de l’entreprise. En combinant le cadre européen (règlement 2018/1807 et Data Act), une cartographie fine des risques et un contrat robuste, vous sécurisez vos flux sans freiner l’innovation.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans chaque étape d’un projet de transfert de données vers un tiers pays : audit de vos actifs, rédaction de clauses adaptées, négociation avec vos partenaires et défense de vos droits en cas de litige.
RESSOURCES :
- Règlement (EU) 2018/1807 du 14 novembre 2018 sur le free flow of non‑personal data.
- Règlement (EU) 2023/2854 (Data Act), art. 5 et 35.
- Code de la propriété intellectuelle, art. L. 341‑1 s. et L. 342‑1 s.
- Deshoulières Avocats, » Droit sui generis : comment protéger votre base de données ? «