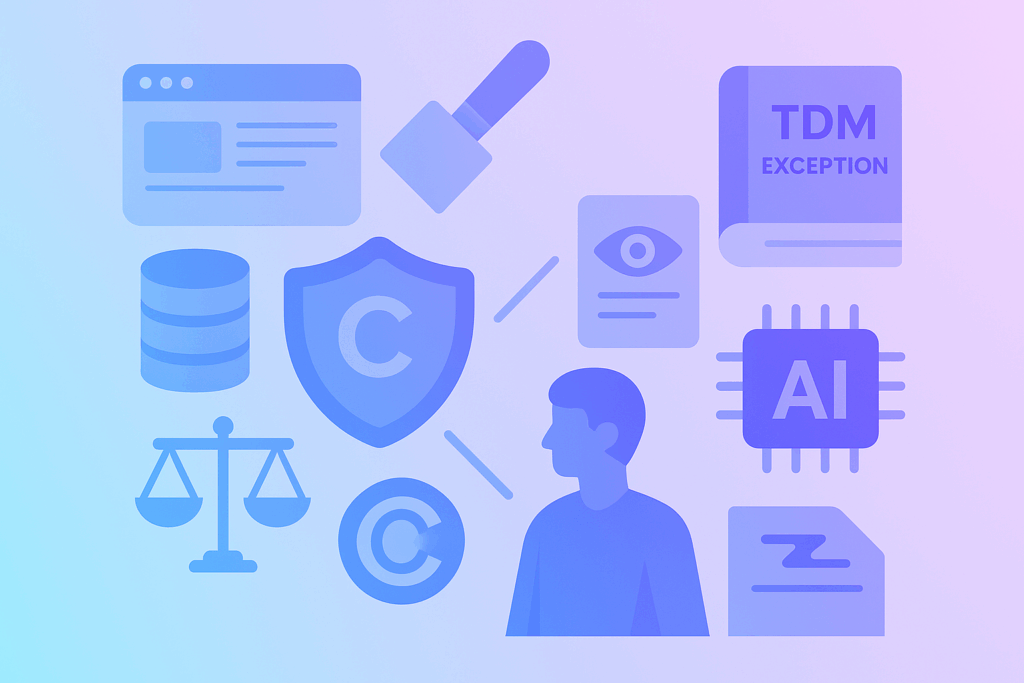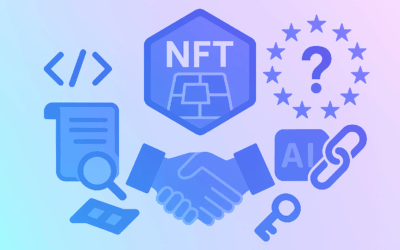Le metaverse bouleverse déjà les repères de la propriété intellectuelle. Les marques y gagnent de nouveaux canaux d’expression mais s’exposent aussi à une dilution visuelle inédite, nourrie par les jumeaux numériques, les NFT et la contrefaçon virtuelle. Comprendre les fondements juridiques et anticiper les risques devient crucial pour préserver la valeur d’un signe distinctif.
La dilution visuelle : un danger amplifié par l’immersion
Le consommateur navigue désormais dans des mondes persistants où les stimuli sont omniprésents. Dans ces espaces, la marque peut perdre son pouvoir distinctif si sa représentation se banalise ou se trouve associée à des environnements inappropriés. Le phénomène tient à la logique même du metaverse : abondance d’avatars, multiplicité de copies, instantanéité des partages.
La jurisprudence européenne sanctionne déjà la dilution hors ligne lorsque l’usage nuit à la fonction d’origine. En environnement virtuel, le risque est démultiplié par l’absence de barrières physiques : un logo peut apparaître sur un objet 3D non autorisé ou flotter dans un espace créé par un tiers. Le rapport du World Economic Forum rappelle que l’essor des NFT accroît encore cette exposition, car chaque jeton véhicule l’image de la marque sur une blockchain publique et pérenne.
Pour l’entreprise, l’enjeu n’est plus seulement d’attaquer la contrefaçon classique. Dorénavant, il s’agit d’éviter que l’œil de l’utilisateur assimile la marque à un simple décor parmi d’autres, au point d’en affaiblir la valeur marketing.
Fondements juridiques : le droit des marques s’adapte
Le droit positif offre déjà des outils. L’article 10 de la Directive UE 2015/2436 protège la marque renommée contre l’usage sans juste motif qui lui porte préjudice. Les tribunaux pourraient transposer cette logique aux univers immersifs. De leur côté, les lignes directrices de l’EUIPO admettent que les « virtual goods » relèvent de la classe 9 ; elles exigent une description précise pour garantir la sécurité juridique. Déposer la marque pour cette classe devient donc la première parade.
Par ailleurs, le DSA impose aux grandes plateformes de commerce virtuel de faire figurer clairement la marque ou le logo du professionnel, ainsi que toute information précontractuelle pertinente. Cette transparence améliore la traçabilité et facilite la preuve d’atteinte.
Enfin, le rapport WIPO Magazine souligne qu’aucune réforme radicale n’est nécessaire : le cadre existant reste pertinent si l’on applique les principes à la technologie émergente. Autrement dit, le droit évolue par interprétation et par bonnes pratiques, non par réinvention complète.
Stratégies préventives pour protéger la marque : dépôt, veille et réaction rapide
D’abord, élargissez votre portefeuille. Déposez votre marque dans les classes couvrant les biens virtuels, les services de divertissement en ligne et les logiciels. Ce réflexe bloque les imitateurs qui misent sur la nouveauté technologique pour s’installer.
Ensuite, surveillez en continu les marketplaces et les plateformes de réalité étendue. Les outils de scraping blockchain permettent de détecter les NFT non autorisés, tandis que les programmes de « trusted flaggers » accélèrent les retraits selon le DSA.
Lorsque l’atteinte est avérée, privilégiez la notification amiable : la plupart des opérateurs suppriment vite les contenus litigieux pour éviter le risque de responsabilité accrue lié à la notion de « conscience » introduite par l’article 6 du DSA.
Enfin, constituez la preuve. Conservez des captures d’écran horodatées, le hash du fichier 3D et, si possible, le smart‑contract associé à l’actif numérique. Ces éléments facilitent la demande d’injonction fondée sur l’article 11 de la directive 2004/48/CE et réduisent la durée du contentieux.
Coopérer avec les acteurs du metaverse pour limiter la dilution visuelle de la marque
Prévenir vaut mieux que guérir. Engagez un dialogue technique avec les développeurs de moteurs 3D afin d’intégrer des filtres de marque : seules les adresses blockchain autorisées peuvent afficher le logo. Ensuite, formez les créateurs indépendants. Guides de style, licences claires et kits de ressources encouragent un usage conforme et segmentent les déclinaisons autorisées.
Parallèlement, profitez des obligations nouvelles des « très grandes plateformes » : celles‑ci doivent ouvrir leurs bases de données publiques aux chercheurs agréés, facilitant l’audit des atteintes systémiques.
Enfin, anticipez la contrefaçon virtuelle en contractualisant. Lorsqu’un studio développe un espace immersif pour votre marque, insérez des clauses de contrôle des copies et des mécanismes d’alerte automatique en cas d’usage externe. Vous réduisez ainsi le volume d’incidents et maintenez l’unicité visuelle du signe.
Conclusion
La marque conserve sa force si elle reste unique dans l’esprit du public. Dans le metaverse, cette unicité repose sur une combinaison d’enregistrements adaptés, d’une surveillance technique fine et d’actions juridiques proportionnées. Agissez tôt, dialoguez avec les plateformes et utilisez le DSA comme levier : vous préserverez votre capital immatériel et éviterez la dilution visuelle.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans le dépôt, la veille et la défense de vos marques, y compris face à la contrefaçon virtuelle et aux défis du metaverse.
RESSOURCES :
- EUIPO, Trade‑mark Guidelines, section 5.9 « Virtual goods versus real‑world goods ».
- Règlement (UE) 2022/2065, dit Digital Services Act.
- Directive (UE) 2015/2436 et Directive 2004/48/CE.