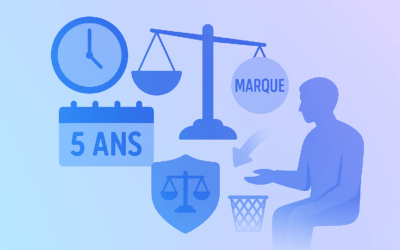La marque dort ? Le droit s’éteint. Depuis l’ordonnance n° 2019-1169, la France dispose d’une procédure administrative rapide pour « débrancher » les marques non exploitées et fluidifier le registre. À quelles conditions la déchéance peut-elle être demandée ? Qui est compétent ? Comment prouver l’usage ? Quels sont les effets concrets pour le titulaire et pour les tiers ? Suivez le fil.
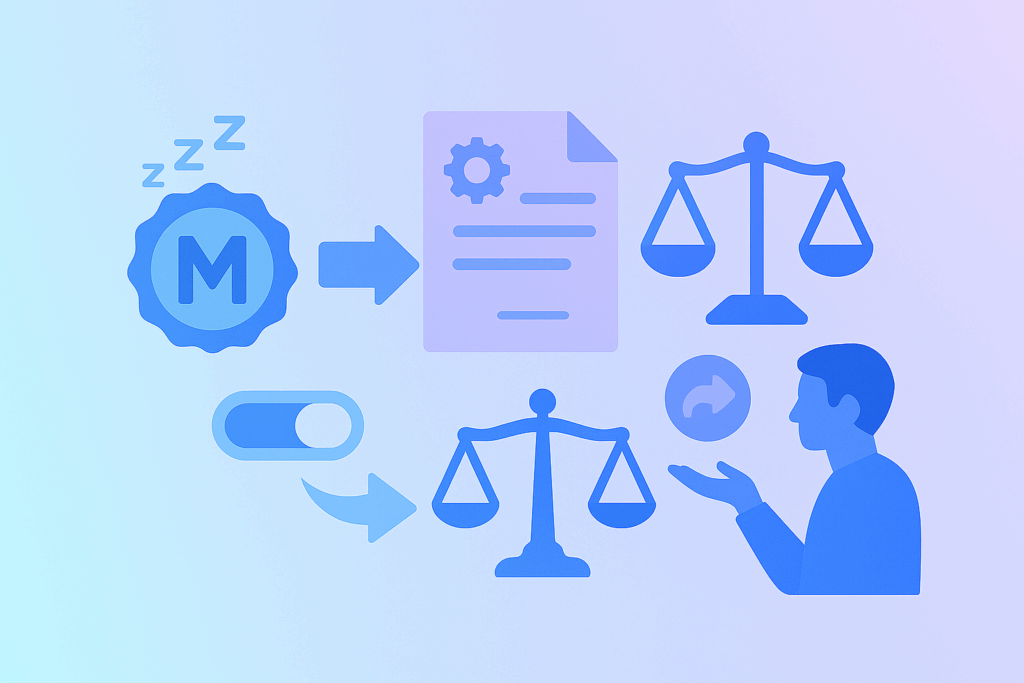
1) Une réforme décisive : de la directive 2015/2436 à l’ordonnance de transposition
D’abord, souvenez-vous du texte européen : l’article 45 de la directive 2015/2436 impose aux États membres d’ouvrir, en plus de la voie judiciaire, une procédure administrative de déchéance de la marque et de sa nullité devant l’office national. Objectif double : épurer les registres et offrir aux entreprises une solution plus rapide, moins coûteuse que le tribunal.
La France a transposé cette exigence par l’ordonnance du 13 novembre 2019, entrée en vigueur le 1ᵉʳ avril 2020. Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) a ainsi été refondu :
- Articles L. 716-1 à L. 716-5 : compétence et procédure devant l’INPI.
- Articles R. 716-1 à R. 716-15 : modalités pratiques (requête en ligne, délais, échanges écrits, pouvoir du directeur général).
Pourquoi une compétence exclusive de l’INPI au principal ? Pour calquer le modèle de la marque de l’Union européenne : la nullité ou la déchéance principales d’une EUTM relèvent déjà de l’EUIPO. Résultat : en France, l’INPI tranche la plupart des dossiers nationaux, tandis que les tribunaux judiciaires n’interviennent qu’en défense ou dans les cas limitativement listés (action connexe, mesures provisoires déjà ordonnées, etc.).
2) Qui juge quoi pour la déchéance de la marque ?
Ensuite, clarifions la répartition :
- Marque française ou internationale visant la France
- Au principal : INPI (art. L. 716-1).
- En défense (action reconventionnelle) : tribunal judiciaire lorsque la déchéance est soulevée face à une contrefaçon, une concurrence déloyale ou une action contractuelle, ou encore si une demande judiciaire a été introduite avant la saisine de l’INPI.
- Marque de l’Union européenne (EUTM)
- Au principal : EUIPO (art. 63 RMUE).
- En défense : tribunal de marque de l’UE saisi de l’action en contrefaçon (art. 128 RMUE et art. 132 pour le sursis).
- Cas de connexité
- Si une action en contrefaçon est engagée avant la requête INPI, la demande de déchéance suit obligatoirement le contentieux principal devant le tribunal pour éviter un éclatement des débats. L’INPI se déclare alors incompétent.
La procédure INPI, 100 % dématérialisée, se déroule en trois temps : pré-instruction (recevabilité), instruction contradictoire, décision motivée. Le recours se porte devant l’une des dix cours d’appel spécialisées, en plein contentieux (nouveaux arguments et pièces admis). Côté EUTM, la logique est analogue : division d’annulation, chambres de recours, Tribunal de l’UE, puis CJUE.
3) Prouver ou périr par la déchéance de la marque : charge, nature et valeur des preuves
Cependant, tout se joue sur l’usage sérieux. La charge de la preuve pèse toujours sur le titulaire (CPI L. 716-3-1 ; dir. 2015/2436 art. 19 ; RMUE art. 58).
Pour convaincre, montrez :
- Lieu – exploitation en France (marque nationale) ou dans l’UE (EUTM).
- Durée – cinq ans ininterrompus avant la demande ou la reconvention.
- Importance – volume commercial appréciable au regard du secteur.
- Nature – usage public orienté client, non symbolique.
Factures, catalogues datés, publicités géolocalisées, captures Web archivées, rapports de ventes certifiés : ces pièces constituent le socle. Les déclarations unilatérales n’emportent jamais la décision si elles ne sont pas corroborées. Le juge ou l’INPI apprécie l’ensemble ; un déficit sur un critère peut être compensé par la force des autres. L’arrêt Big Mac Chicken (TUE, 2024) rappelle que la renommée d’une marque ne dispense pas de chiffres datés et précis pour éviter la déchéance de la marque.
4) Effets et date d’effet de la déchéance de la marque
Enfin, que produit la décision de déchéance de la marque ?
- Force exécutoire : la décision INPI a la valeur d’un jugement (CPI L. 716-1 al. 3).
- Date d’effet :
- Par défaut, à la date de la demande (ou de la reconvention).
- Sur requête d’une partie, elle peut être fixée à la date plus ancienne où le motif est apparu (CPI L. 716-3 al. 5 ; RMUE art. 62).
- Étendue : totale ou limitée aux produits/services non exploités.
- Inscription au registre : publication après expiration du délai de recours ou remise d’un certificat de non-appel.
Lorsque la marque tombe, le signe redevient disponible et peut être redéposé par un tiers. Mais le nouveau titulaire devra exploiter sérieusement dans les cinq ans, faute de quoi l’histoire se répétera.
Conclusion
La déchéance pour non-usage est devenue un levier stratégique. Étudiez la compétence, rassemblez des preuves robustes, visez la date d’effet la plus favorable et, côté titulaire, archivez systématiquement vos pièces d’usage. Une marque est un droit vivant ; mieux vaut l’entretenir que la voir s’éteindre.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle : L. 716-1 à L. 716-5 et L. 716-3-1
- Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019
- Directive (UE) 2015/2436, art. 45 et 58
- Règlement (UE) 2017/1001, art. 58 à 64
- CJUE, 10 mars 2022, Maxxus, C-183/21