Déposer une marque n’est qu’un début. Encore faut‑il l’utiliser, sur le bon territoire, dans le délai imparti et d’une façon qui parle vraiment au public. Faute de quoi, cinq ans d’inaction suffisent à faire tomber le monopole. Ce guide vous dévoile, étape par étape, les trois piliers qui sauvent un titre : la territorialité, le délai d’inexploitation et l’usage sérieux.
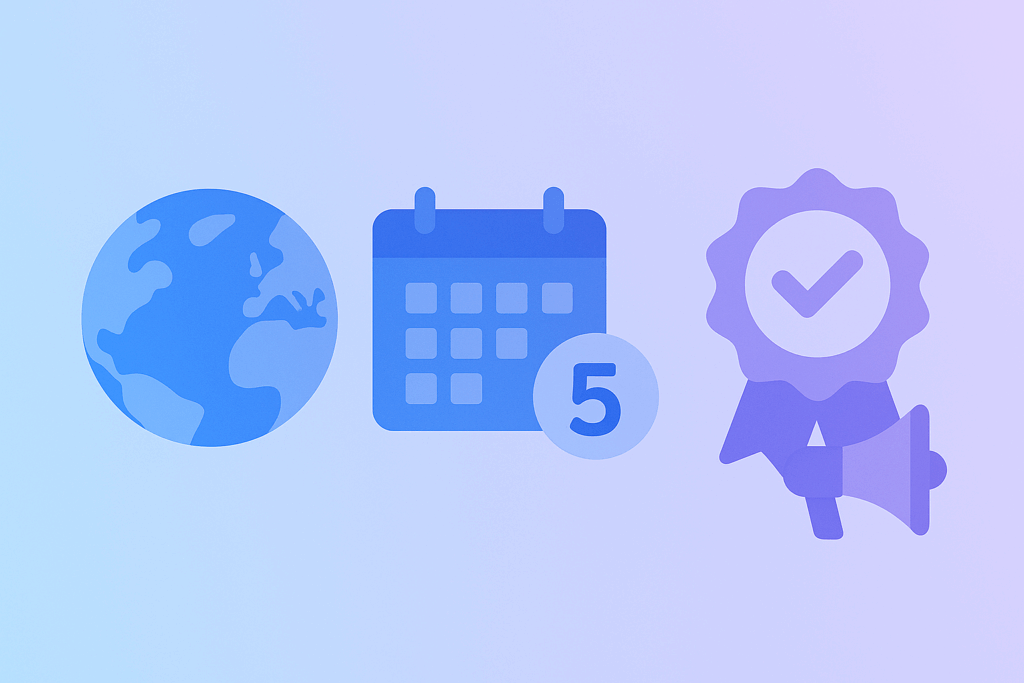
1) Territorialité : où votre marque doit‑elle vivre ?
Le droit est sans équivoque : chaque titre doit être visible là où il prétend protéger. Pour une marque française, l’exploitation doit viser la clientèle nationale – DROM‑COM compris. Quelques échantillons importés ou une publicité dans un magazine étranger ne suffisent pas. L’apposition pour l’exportation, tolérée par l’article L. 714‑5 4° du Code de la Propriété intellectuelle, reste une dérogation stricte : la marque ne touche jamais le marché français et doit donc être prouvée avec rigueur.
Pour la marque de l’Union européenne, la règle est plus nuancée. La Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt Onel/Omel) refuse la barre nationale : un usage limité peut suffire si le marché concerné est restreint ou très spécialisé. En pratique, mieux vaut viser plusieurs États membres ou, à défaut, prouver que le produit n’a de sens que localement (ex. spécialité régionale). L’option de transformation (art. 139 RMUE) sauve malgré tout le dépôt : le titulaire convertit la MUE en titres nationaux et conserve sa date de dépôt.
Brexit, DROM‑COM, PTOM : des territoires à statut hybride compliquent la carte. Le clone britannique né le 1ᵉʳ janvier 2021 reste sauf, mais l’usage au Royaume‑Uni n’entretient plus la MUE. Les exploitations outre‑mer comptent en droit français, mais pas forcément pour la MUE. Vérifiez donc toujours la zone exacte où vous vendez, livrez ou faites livrer – et accumulez des preuves locales.
2) Délai d’inexploitation : le compte à rebours de cinq ans
Le législateur a fixé un « délai de grâce » : cinq ans à compter de la publication de l’enregistrement (ou du dernier acte d’usage) pour commencer ou poursuivre l’exploitation. Passé ce cap, toute marque devient attaquable. Ce délai se calcule produit par produit, service par service ; il repart à zéro dès qu’un acte d’usage sérieux intervient.
La notion de « période suspecte » protège la négociation amiable : relancer la marque dans les trois mois qui précèdent une action en déchéance ne sert à rien si le titulaire savait la procédure imminente. Courriers AR, mises en demeure ou simples échanges de mails suffisent à prouver cette connaissance.
Attention aux idées reçues : céder la marque, la renouveler ou redéposer un signe quasi identique n’efface pas l’inexploitation. Le cessionnaire hérite du passif ; le renouvellement prolonge seulement le même titre ; un nouveau dépôt trop opportun sera jugé frauduleux. Seule une vraie reprise de ventes, avant la période suspecte, sauve le droit – encore faut‑il que cette reprise soit sérieuse, régulière et visible de la clientèle.
3) Usage sérieux : volume, régularité et fonction d’origine pour l’exploitation de la marque
Un usage sérieux n’est pas une formalité. Il doit remplir la fonction essentielle de la marque : garantir l’origine des produits ou services. La CJUE (Ansul) exige un usage non symbolique, tourné vers le marché, même s’il est modeste. Quelques chiffres clés :
- Volume : le tribunal juge à l’échelle du secteur. 100 valises de luxe par an peuvent suffire ; 10 000 canettes dans toute l’UE peuvent échouer.
- Régularité : mieux vaut mille pièces chaque année que 5 000 d’un seul coup.
- Visibilité : la marque doit être perçue comme telle ; un usage décoratif, un nom de domaine inactif ou une enseigne sans produits identifiables ne comptent pas.
- Pièces détachées : la vente d’accessoires, de consommables ou de services après‑vente entretient aussi la marque principale, comme l’a confirmé l’arrêt Ferrari (2020).
Qui peut procéder à l’exploitation de la marque ? Le titulaire, bien sûr, mais aussi tout tiers expressément ou tacitement autorisé (licencié, filiale, membre d’une marque collective). La clé est la preuve du consentement ; sans elle, l’usage du tiers est inopérant. Un contrat écrit enregistré facilite la tâche, mais un faisceau d’indices suffit (rapports internes, factures, organigrammes de groupe).
Ce qui ne fonctionne pas :
- Usage interne ou expérimental ;
- Publicités sans mise sur le marché ;
- Dépôts de noms de domaine inactifs ;
- Titres d’œuvres ou slogans déconnectés des produits.
Enfin, l’usage doit viser les produits et services exacts revendiqués. Depuis l’arrêt IP Translator et l’article 39 de la directive 2015/2436, l’INPI et l’EUIPO exigent une désignation claire. Si vous exploitez uniquement des « cravates » sous le large libellé « vêtements », vous risquez la déchéance pour les autres pièces. Les juges taillent désormais dans les listes et ne sauvent que les sous‑catégories réellement prouvées.
4) Stratégie : monter, garder et prouver son usage et exploitation de la marque
- Planifiez : dès le dépôt, déterminez les zones de vente réalistes et les produits prioritaires.
- Collectez : factures, bons de livraison, photos de rayons, captures d’écran, contrats de licence ; classez‑les par année et par pays.
- Révisez : tous les trois ans, vérifiez la cohérence du libellé avec l’activité réelle – un dépôt complémentaire coûte moins qu’une action défensive.
- Surveillez : mettez en place une veille registre et web ; agir vite limite la période suspecte.
- Documentez : exigez de vos licenciés ou franchisés des comptes‑rendus trimestriels et conservez‑les au même titre que vos propres pièces.
Conclusion
Territoire, délai, usage : voilà le triptyque qui maintient la vie d’une marque. Une présence régulière sur le marché pertinent, prouvée et ciblée, transforme un simple dépôt en droit solide. Sans ces trois piliers, cinq ans de silence suffisent à tout perdre – même pour les géants mondiaux.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle : art. L. 714‑5, L. 716‑3, R. 712‑3‑1
- CJUE : 11 mars 2003, C‑40/01 (Ansul) ; 19 déc. 2012, C‑149/11 (Onel/Omel) ; 15 janv. 2009, C‑495/07 (Silberquelle) ; 22 oct. 2020, C‑720/18 & C‑721/18 (Ferrari)
- Règlement (UE) 2017/1001, art. 18, 58 et 139
- Directive (UE) 2015/2436, art. 16, 19, 39 et 44
- Cass. com., 30 nov. 2004, n° 02‑18.731 ; 21 janv. 2014, n° 13‑12.501


