Déposer un signe ne suffit pas : le droit impose un usage sérieux dans un délai précis. Passé cinq ans sans exploitation, le risque de la déchéance de la marque court. Comprenez pourquoi ce délai existe, comment il se calcule et comment le rattraper à temps.
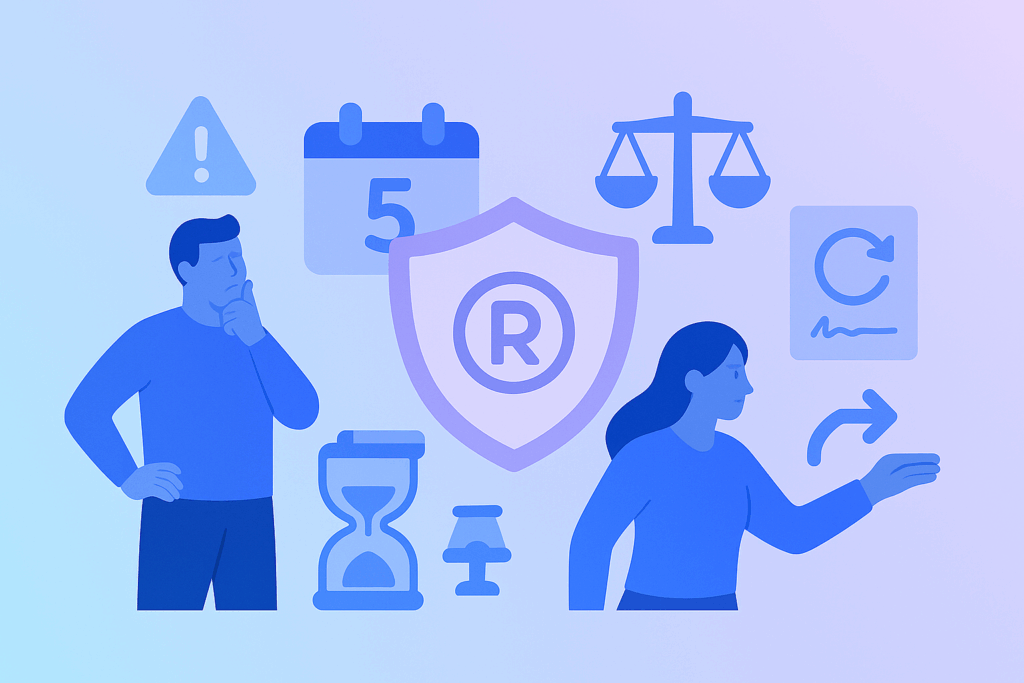
1) Pourquoi la loi sanctionne l’inaction ?
Le monopole qu’offre l’enregistrement n’est pas un simple trophée : il doit vivre sur le marché. Le législateur a donc prévu la déchéance pour inexploitation prolongée. Objectif : purger les registres des marques dormantes et libérer la concurrence. Sans usage sérieux, la marque devient une « res nullius » : chacun peut la reprendre. La directive (UE) 2015/2436, le règlement 2017/1001 et l’article L. 714‑5 CPI l’affirment : cinq ans de silence et le titre vacille.
2) Comment compter les cinq années d’inexploitation entraînant la déchéance de la marque ?
Le délai se calcule à partir de l’enregistrement – non plus « à rebours » comme avant 1991.
- Pour une marque française, le point zéro correspond à la publication au BOPI.
- Pour une marque de l’Union, c’est la publication au Bulletin de l’EUIPO.
- Même logique pour une internationale désignant la France : on démarre une fois les délais d’opposition expirés.
Le dernier acte d’usage sérieux redonne un nouveau départ : si vous vendez vos produits le 3 mars 2023, le compteur avant la déchéance de la marque repart jusqu’au 3 mars 2028. La Cour de justice qualifie ce laps de « délai de grâce » : cinq ans pour lancer la marque en toute légitimité.
3) Reprendre l’usage sauve-t‑il toujours de la déchéance de la marque ?
Bonne nouvelle : renouer avec un usage sérieux avant qu’on ne vous attaque stoppe la déchéance de la marque. Mauvaise nouvelle : cet effet curatif connaît des limites. Si vous redémarrez dans les trois mois précédant la demande en déchéance, l’adversaire peut faire écarter ces actes s’il prouve que vous saviez l’action imminente. Ce filtre protège la négociation amiable et évite les rattrapages opportunistes.
De plus, la reprise doit être réelle : ventes effectives, factures, publicité ciblée. Une facture isolée pour douze bouteilles ne convaincra pas les juges.
4) La période suspecte : les trois mois sous haute vigilance
Entre l’expiration des cinq ans et l’assignation, chaque jour compte. La loi instaure une « période suspecte » de trois mois. Reprendre l’usage pendant cette fenêtre est inopérant si le titulaire a été alerté du risque de déchéance de la marque. Lettres recommandées, mises en demeure, emails datés : l’assaillant doit prouver la connaissance.
Les tribunaux scrutent alors les preuves : langue du site, factures, volume de ventes. Passé ce délai ou sans alerte, la reprise reste valable et peut sauver la marque.
Conclusion
L’inexploitation prolongée est une condition centrale de la déchéance de la marque. Cinq ans d’inaction suffisent à fragiliser votre titre ; trois mois suffisent à contrer une attaque… ou à perdre la bataille. Anticipez : gardez des preuves d’usage, surveillez vos marchés et réagissez avant qu’un concurrent n’en profite.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle, art. L. 714‑5 et L. 716‑3
- Directive (UE) 2015/2436, art. 19 § 2 et 3
- CJUE, 21 déc. 2016, aff. C‑654/15 (Länsförsäkringar)
- Cass. com., 21 janv. 2014, n° 13‑12.501
- Deshoulières Avocats, « Protéger sa marque«


