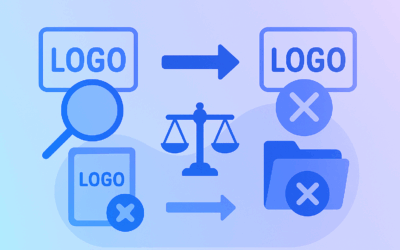Déposer une marque, c’est bien. L’utiliser, c’est indispensable. Le droit impose un usage sérieux sur un territoire donné. Faute de quoi, votre titre peut tomber en déshérence. France, Union européenne, outre-mer : où faut-il procéder à l’exploitation de la marque ? Et comment prouver un usage suffisant ?
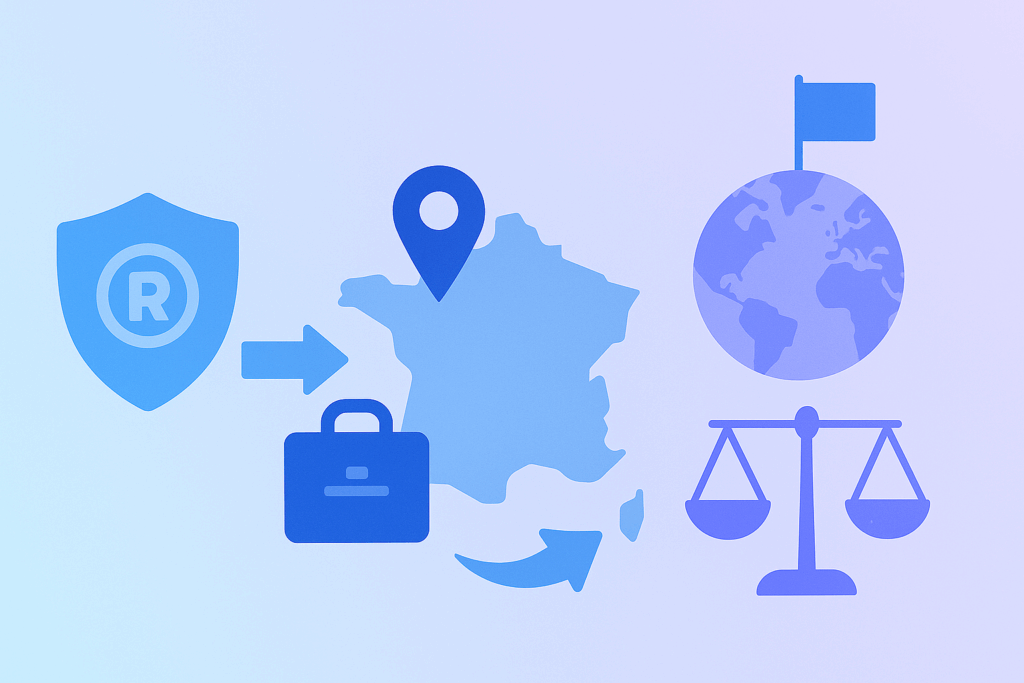
1) Sans usage, pas de monopole : la marque devient vulnérable
Une marque enregistrée mais inactive n’est plus protégée. En droit des marques, le monopole d’exploitation de la marque n’est justifié que si le titulaire utilise son signe de manière sérieuse, continue et cohérente. À défaut, la loi organise sa déchéance pour non-usage, une procédure qui libère le signe pour les tiers intéressés.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE du 22 mai 2019, il est désormais possible de demander cette déchéance de la marque directement devant l’INPI. Cette évolution a profondément modifié la stratégie de contentieux : plus rapide, moins coûteuse, la procédure est devenue un levier courant pour faire tomber des marques dormantes. Pour s’en prémunir, le titulaire doit prouver un usage sérieux, conforme aux exigences du droit français ou européen, selon la nature de la marque déposée.
2) En droit français : un usage tourné vers le marché national
Lorsqu’il s’agit d’une marque française, les preuves d’usage doivent montrer une exploitation sur le territoire français. Les juridictions rejettent les indices trop faibles : une importation isolée ou une publicité dans un média étranger accessible en France ne suffisent pas. Au contraire, il faut démontrer une véritable activité économique, comme des ventes, des contrats commerciaux, ou une campagne publicitaire visant expressément le public français.
Les territoires ultramarins (DROM-COM) peuvent être pris en compte, mais de manière nuancée. En effet, certains arrêts ont admis que l’exploitation dans ces zones pouvait équivaloir à un usage national. Toutefois, si cette exploitation demeure marginale ou exceptionnelle, la déchéance peut tout de même être prononcée. Ce qui compte, c’est l’intensité de l’activité et sa portée géographique.
En parallèle, une exception existe pour les produits destinés à l’exportation. Si la marque est apposée en France sur des biens exportés, cet usage est reconnu comme sérieux. Attention cependant : il faut apporter des preuves concrètes, datées, et localisées.
3) En droit européen : un usage dans l’Union, pas seulement dans un pays
Les règles changent lorsqu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne (MUE). Ici aussi, l’usage doit être sérieux. Mais l’échelle d’appréciation est celle de l’Union dans son ensemble, et non d’un seul pays. La CJUE l’a rappelé dans l’arrêt Onel/Omel (C-149/11) : l’usage dans un seul État membre peut suffire, à condition qu’il soit économiquement pertinent.
Ce qui importe, ce n’est pas le nombre de pays concernés, mais l’ampleur de l’exploitation. Une activité commerciale soutenue dans un seul pays, avec des volumes de vente significatifs, peut suffire à écarter la déchéance de la marque. À l’inverse, un usage dispersé mais faible dans plusieurs États ne sera pas toujours considéré comme valable.
Il convient également de noter qu’en cas d’usage exclusivement localisé, le titulaire peut demander la transformation de sa marque européenne en marque nationale. Ce mécanisme permet de sauvegarder ses droits, tout en adaptant leur portée au périmètre d’exploitation réel.
4) Internet, exportation, communication : distinguer l’usage effectif du simple affichage
L’usage d’une marque en ligne soulève des difficultés spécifiques. Un site internet accessible depuis la France ne constitue pas automatiquement une preuve d’usage en France. Pour convaincre, il faut montrer une volonté de cibler ce marché : langue utilisée, devise affichée, service de livraison, mentions légales françaises, etc.
De la même manière, apposer une marque pour l’exportation reste une modalité d’usage reconnue. Toutefois, cette apposition doit intervenir sur le territoire pertinent, avec des preuves tangibles (photographies des produits, bons de livraison, factures, etc.). Un usage théorique ou préparatoire ne suffit pas.
Dans le domaine des services, l’analyse se complexifie. Un hôtel américain promu via un site français, en euros, avec la possibilité de réserver depuis la France, peut constituer un usage valable. Les juges examinent la cible commerciale et la nature de la prestation.
Enfin, il est essentiel de distinguer certaines situations qui ne relèvent pas d’un usage sérieux : stockage sans commercialisation, transit, opérations internes à l’entreprise. Seule une exploitation tournée vers le public pertinentpermet d’échapper à la déchéance.
5) Cas particuliers : Brexit, DROM-COM et marques clonées
La question du territoire d’usage devient particulièrement complexe lorsqu’il s’agit de zones à statut spécial. C’est notamment le cas des territoires d’outre-mer français. Si le droit national accepte l’usage dans un DROM-COM comme valable, le droit européen opère une distinction entre les Régions ultrapériphériques (RUP), pleinement intégrées à l’UE, et les Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM), qui bénéficient d’une plus grande autonomie. Ainsi, une marque utilisée en Guadeloupe pourra être protégée au titre d’une MUE, mais ce ne sera pas le cas pour une exploitation en Nouvelle-Calédonie.
Depuis le Brexit, l’usage d’une marque au Royaume-Uni n’est plus valable pour maintenir une MUE. Pour pallier cela, des marques clonées ont été automatiquement créées en Grande-Bretagne à partir des titres européens existants. Chacune de ces marques évolue désormais indépendamment, selon les règles de son propre territoire.
Enfin, les conventions internationales ne permettent plus de contourner les exigences territoriales. Seul un usage conforme aux conditions posées par le droit français ou européen permet d’éviter la déchéance.
Conclusion
La déchéance pour non-usage constitue aujourd’hui un outil central du droit des marques. Elle permet d’éliminer les signes inutilisés, tout en rééquilibrant la concurrence. Mais pour éviter d’en être victime, le titulaire doit agir avec rigueur : suivre la territorialité, conserver des preuves solides, adapter sa stratégie au cadre juridique applicable.
Avant de lancer une procédure ou de répondre à une mise en cause, une seule question doit être posée : votre marque a-t-elle été exploitée réellement, sur le bon territoire, dans les cinq dernières années ?
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :