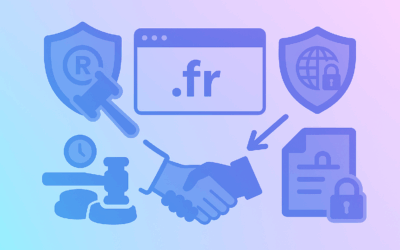Déposer une marque, c’est obtenir un monopole sur un signe. Mais ce privilège ne doit pas étouffer la liberté du commerce. D’abord borné par le principe de spécialité, le droit des marques accorde pourtant une exception aux marques renommées. Comprendre cette tension aide les entrepreneurs à sécuriser leurs actifs tout en respectant la concurrence.
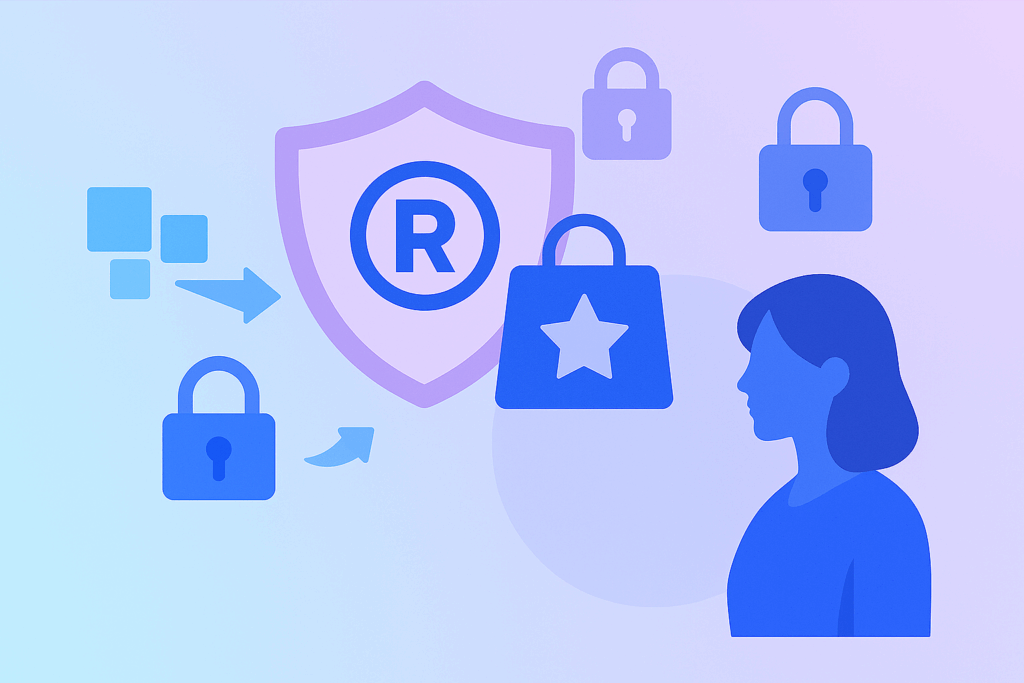
Le principe de spécialité : clé de voûte de la concurrence loyale
Le droit français impose de relier chaque marque à des produits ou services précis. Cette exigence, issue du principe de spécialité, sert de garde-fou : elle évite qu’un déposant privatise un mot ou un logo pour tous les secteurs. Ainsi, la référence « Mont Blanc » peut identifier des entremets sans interdire son usage pour des stylos. Le consommateur y gagne une information fiable sur l’origine commerciale, tandis que les acteurs économiques conservent un vocabulaire commun.
En pratique, l’INPI rejette tout dépôt vague ou trop englobant. Le monopole reste donc proportionné au besoin réel de l’entreprise. Grâce à cette règle, la courbe entre protection et marché libre reste équilibrée : la marque signale l’origine, mais ne fige pas l’innovation des concurrents.
Quand la marque de renommée bouscule la spécialité
Cependant, certaines marques dépassent leur catégorie initiale. Leur éclat leur confère une renommée telle qu’elles rayonnent au-delà des produits visés au dépôt. Pour préserver cette valeur, le Code de la propriété intellectuelle autorise leur titulaire à agir contre des atteintes commises hors spécialité, lorsqu’un tiers cherche à profiter indûment de la réputation du signe ou à l’affaiblir.
La CJUE l’a rappelé dans l’arrêt ÖKO-Test : si un fabricant de dentifrice continue d’apposer un label après expiration de sa licence, il exploite la notoriété acquise et porte préjudice au caractère distinctif de la marque-label. De même, le logo « Tongue and Lips » des Rolling Stones, célèbre bien au-delà du textile, obtient une large protection contre des imitations mêlant un drapeau breton.
La logique est simple : plus une marque polarise l’attention du public, plus le risque de parasitisme grandit ; la loi élargit donc le bouclier, mais exige la preuve d’un profit ou d’un préjudice injustifié.
Définir et prouver la renommée : un défi pratique
Reconnaître qu’un signe est « renommé » ne relève pas de l’intuition ; le juge apprécie des indicateurs concrets. Il examine la part de marché, l’intensité de la communication, la durée d’usage et les investissements publicitaires.
La jurisprudence General Motors exige qu’une « fraction significative » du public concerné connaisse la marque. Ce public n’est pas forcément l’ensemble des consommateurs ; pour un équipement médical, l’audience pertinente se limite aux professionnels de santé.
Le déposant doit réunir enquêtes, chiffres de vente, coupures de presse et preuves de sponsoring. Une marque d’usage, même non enregistrée, peut démontrer sa notoriété par un festival diffusé nationalement, comme l’a jugé la cour d’appel de Douai pour « Made in Évreux ». À l’inverse, si la marque ne vit que dans un cercle étroit, l’action hors spécialité échoue. Cette dualité incite les entreprises à documenter systématiquement leurs efforts de promotion ; un dossier probant vaut autant qu’un slogan percutant.
Étendue territoriale de la protection : jusqu’où va la marque de renommée ?
La renommée doit rayonner sur une « partie substantielle » du territoire pertinent. Pour une marque française, la Cour de cassation refuse de se limiter au seul public hexagonal lorsqu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne : le titulaire doit prouver sa célébrité dans un État membre entier ou dans plusieurs régions clés de l’Union.
L’arrêt Pago affirme qu’une réputation concentrée dans un État, l’Autriche, peut suffire à déclencher la protection dans toute l’UE. Plus récemment, l’arrêt Iron & Smith nuance : si la marque est inconnue du public hongrois, le lien mental entre les signes peut manquer et l’action sera rejetée.
En d’autres termes, la carte géographique ne suffit pas ; le juge traque l’effet économique réel. Les titulaires doivent donc analyser chaque marché cible avant de plaider l’atteinte hors spécialité, sous peine de se voir opposer l’absence de « lien » dans l’esprit du consommateur local.
Conclusion
Le principe de spécialité protège la liberté de la concurrence en cantonnant le monopole de marque à un périmètre précis. Pourtant, la marque renommée bénéficie d’un filet plus large, justifié par sa valeur d’image. Maîtriser ces deux régimes permet d’arbitrer entre défense du signe et respect du marché. Avant d’agir, collectez vos preuves de renommée, cartographiez votre notoriété et vérifiez l’existence d’un lien dans l’esprit du public. Cette préparation maximise vos chances en cas de litige.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-5
- CJUE, 11 avril 2019, aff. C-690/17, ÖKO-Test
- CJUE, 14 septembre 1999, aff. C-375/97, General Motors
- CJUE, 6 octobre 2009, aff. C-301/07, Pago
- Cour de cassation, ch. com., 5 juin 2019, n° 17-25.665
- Deshoulières Avocats, « Opposition de marque à l’Inpi«