L’entreprise qui conclut une commande d’œuvre, qu’il s’agisse d’une illustration, un logiciel ou une vidéo rêve de l’utiliser librement. Pourtant, en droit français, l’auteur reste maître des droits patrimoniaux tant qu’ils ne sont pas cédés. Sans contrat d’exploitation solide, la diffusion de l’œuvre expose le commanditaire à la contrefaçon. Découvrez comment encadrer votre « contrat de commande », sécuriser la cession de droits d’auteur et éviter les blocages commerciaux.
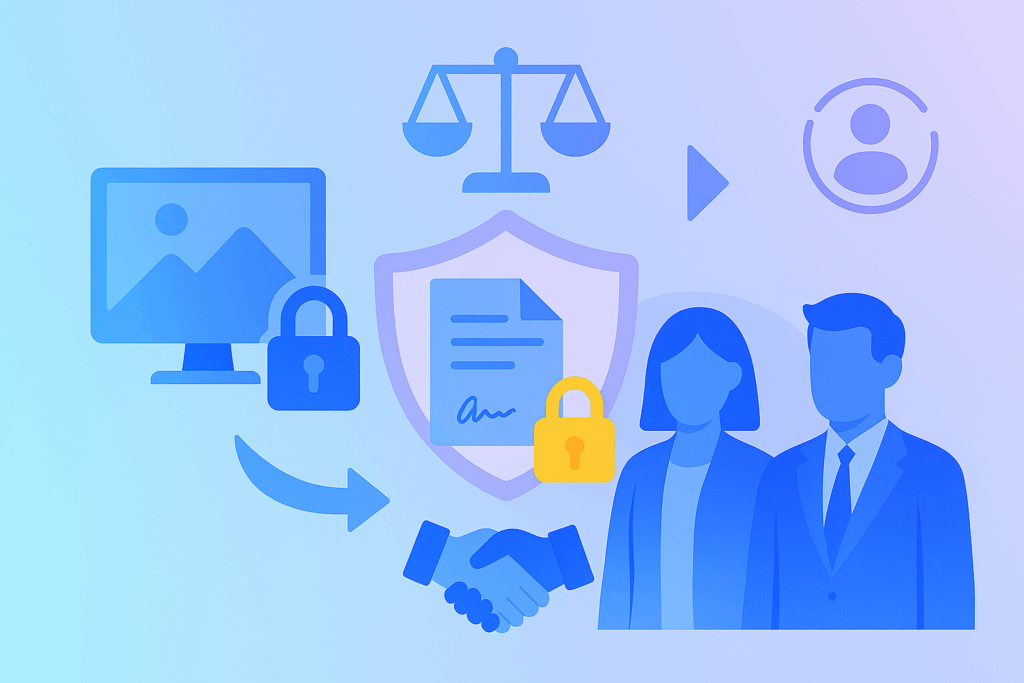
1) Contrat de commande d’œuvre : fondement et champ d’application
Le contrat de commande d’œuvre se conclut avant même l’existence de l’œuvre. Il lie deux volontés :
- Celle de l’auteur, qui s’engage à créer,
- Et celle du commanditaire, qui finance la réalisation.
Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) rappelle d’abord un principe intangible : seul le créateur possède, dès la naissance de l’œuvre, le droit exclusif de reproduction et de représentation. Le simple transfert du support matériel – tableau, fichier source ou prototype – ne transmet jamais ces prérogatives incorporelles. Le juge a maintes fois rappelé cette indépendance. Dès 1910, le législateur l’a gravée dans la loi ; la jurisprudence récente continue de l’appliquer à des fresques, des photos ou des logiciels.
En pratique, la mission est claire : si le commanditaire veut exploiter l’œuvre, il doit négocier une cession expresse, rédigée dans les formes de l’article L. 131-3 CPI. Lorsque la destination première suppose une diffusion – campagne publicitaire, catalogue en ligne, manuel technique – les tribunaux admettent parfois une cession implicite, mais uniquement lorsqu’ils constatent une intention commune d’exploiter. Cette exception demeure fragile ; la prudence contractuelle reste la règle.
2) Le mythe du commanditaire-auteur : pourquoi l’argument ne tient pas
Face à l’absence de clause de cession, certains commanditaires tentent de revendiquer la paternité de l’œuvre. Ils avancent qu’ils ont fourni le sujet, les instructions, parfois même un cahier des charges détaillé. Le droit d’auteur tranche net : l’originalité jaillit de la forme, non de l’idée. Donner des directives ne fait pas de vous un créateur. Les tribunaux réservent le titre d’auteur à celui qui imprime sa personnalité dans l’œuvre, qu’il s’agisse d’un photographe dirigé sur le choix du modèle ou d’un designer guidé par un service marketing.
Seule exception : l’œuvre de collaboration, lorsqu’auteur et commanditaire inventent ensemble, dans une interaction créative constante. Dans ce cas, chaque coauteur détient un droit indivis, et toute exploitation requiert l’accord de tous. Quant à l’œuvre collective, elle investit à titre originaire la personne morale qui l’édite sous son nom, mais seulement si les contributions sont fondues dans un ensemble impossible à attribuer. La jurisprudence réserve cette qualification aux dictionnaires, encyclopédies ou sites web complexes.
Pour la majorité des commandes individuelles, elle refuse donc de déposséder l’artiste. Moralité : sans clause écrite, votre pouvoir d’exploitation reste limité, même si vous avez financé le projet du premier au dernier centime.
3) Cession des droits patrimoniaux dans le contrat de commande d’œuvre : rédiger, délimiter, rémunérer
L’article L. 131-3 CPI fixe plusieurs exigences, rendant obligatoire d’indiquer dans le contrat de commande d’œuvre pour chaque droit cédé :
- L’étendue ;
- La destination ;
- Le territoire ;
- La durée de chaque droit.
Une formule vague du type « tous droits, pour toujours et partout » tombe sous le coup de la nullité. Le contrat doit préciser si la reproduction se fait sur papier, sur internet, sur goodies, et pendant combien d’années. Il doit aussi comporter une clause financière distincte ; le paiement de la prestation technique ne suffit pas. Lorsque les recettes de l’exploitation sont identifiables – ventes de livres, téléchargements, diffusion télé – la rémunération proportionnelle est la norme. Pour une œuvre accessoire (affiche de film, emballage de parfum) ou sans recette directe (affichage publicitaire), la loi tolère une forfaitisation, à condition qu’elle reste sérieuse et transparente.
Dans les secteurs créatifs, on insère souvent une option dans le contrat de commande d’œuvre : l’auteur livre l’œuvre, le commanditaire dispose d’un délai pour activer la cession en versant un complément. Cette mécanique protège l’un et l’autre : l’entreprise ne paie que si elle exploite, l’auteur garde ses droits si le projet tombe à l’eau. Dernier point : la gratuité est possible, mais elle doit être écrite noir sur blanc. À défaut, l’auteur pourra réclamer un supplément au moment où la création prendra de la valeur.
4) Exclusivité, obligation d’exploiter et « risk management »
Céder un droit exclusif, c’est empêcher l’auteur de confier la même exploitation à un tiers. En contrepartie, la jurisprudence impose au cessionnaire d’agir : pas question d’acquérir un film, un logo ou un logiciel pour le ranger au placard. L’obligation d’exploiter découle à la fois de la cause du contrat et de la volonté du législateur d’éviter la mise au congélateur d’œuvres culturelles. Le commanditaire doit donc diffuser dans un délai raisonnable et verser la rémunération correspondante. S’il ne le fait pas, l’auteur peut demander la résiliation et des dommages-intérêts.
Pour réduire ce risque, les praticiens recommandent d’insérer une clause de retour des droits : passé deux ans sans publication, le créateur recouvre sa liberté, sans avoir à saisir le juge. Inversement, si la cession reste non exclusive, l’obligation d’exploiter disparaît ; l’auteur conserve la faculté de monnayer son œuvre auprès d’autres partenaires. D’où l’importance de bien peser les enjeux marketing avant de négocier.
Enfin, n’oubliez pas le droit moral. Même après une cession parfaite, l’auteur peut s’opposer à une dénaturation ou réclamer la paternité. Le contrat ne peut pas lui retirer cette prérogative. Prévoir un droit de regard sur les adaptations majeures évitera des litiges coûteux.
Conclusion
Le contrat de commande est une formidable opportunité de créer sur mesure, mais il n’emporte jamais, par lui-même, la liberté d’exploiter l’œuvre. Pour sécuriser votre investissement, rédigez une cession de droits précise, rémunérez-la distinctement, et respectez le droit moral de l’auteur. En cas de doute, faites auditer vos contrats avant toute diffusion ; le coût d’un conseil est toujours inférieur à celui d’une action en contrefaçon
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en droit de la propriété intellectuelle.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1 à L. 131-9
- Cass. 1re civ., 27 mai 1986 (Renault c/ Casadamont)
- Cass. 1re civ., 21 oct. 1997 (photographe salarié)
- CA Paris, 5 mai 2000 (Galerie de France)
- Deshoulières Avocats, « Cession de droits d’auteur : quatre clauses indispensables »


