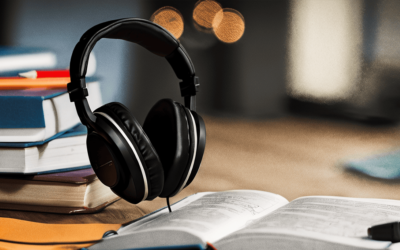Le contrat de commande, et plus particulièrement l’exécution et les obligations de l’auteur, est un outil clé de la propriété intellectuelle permettant à un commanditaire d’obtenir une création sur mesure et à un auteur d’être rémunéré pour son œuvre. Découvrez comment déchiffrer ses mécanismes, obligations et enjeux pratiques.
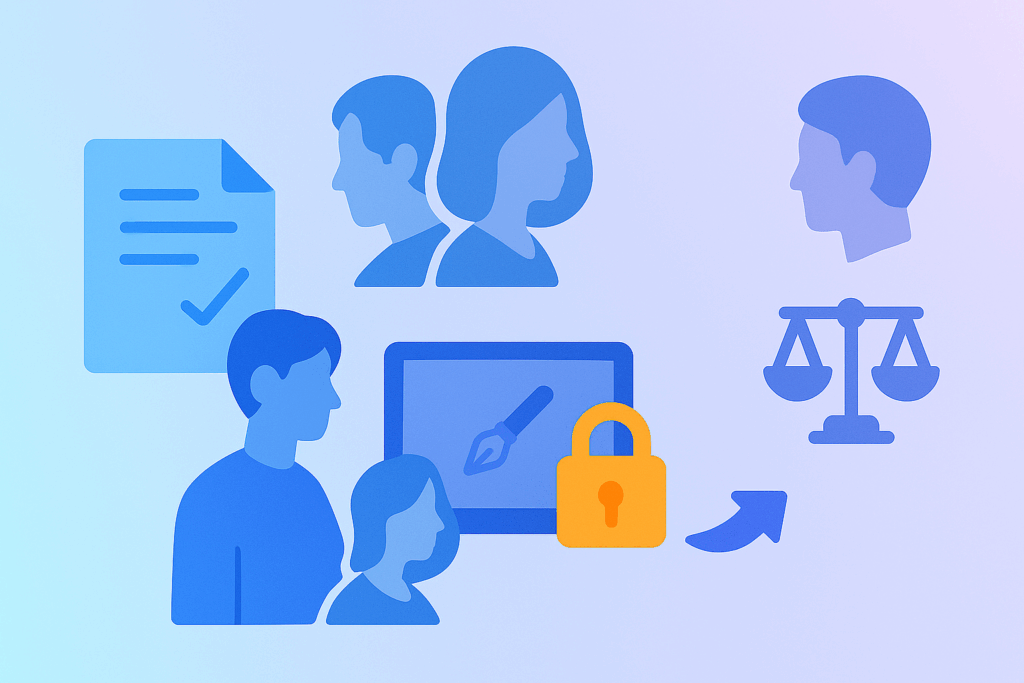
1) Une œuvre sur-mesure commandée à un auteur indépendant
Le contrat de commande lie un auteur à un commanditaire. L’auteur s’engage à créer une œuvre originale, encore inexistante au moment de l’accord. En échange, il reçoit une rémunération.
Ce contrat vise une création intellectuelle. Il ne se confond pas avec le simple contrat d’entreprise. Le choix de l’auteur repose sur un intuitu personae : ses qualités personnelles comptent autant que le résultat final. Cette spécificité explique pourquoi ce type de contrat concerne souvent des œuvres diffusées ou reproduites : logiciels, photographies, contenus web, traductions ou œuvres audiovisuelles.
Parfois, la commande intègre une cession des droits d’exploitation. Le contrat devient alors mixte. Pour les créations publicitaires, un régime particulier s’applique. L’article L.132‑31 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que, sauf clause contraire, les droits sont présumés cédés au producteur.
Enfin, le degré de liberté laissé à l’auteur varie. Une commande peut laisser carte blanche ou imposer un cahier des charges strict. Chaque option a ses avantages et ses risques.
2) Les obligations de l’auteur face au contrat de commande
L’auteur doit créer une œuvre conforme à la commande. Cette exigence peut porter sur la forme, le style, le thème ou des critères techniques : durée, format, fonctionnalités. Son obligation est de moyen renforcée. Il ne garantit pas un résultat déterminé, mais il doit fournir tous ses efforts pour y parvenir.
L’intensité du lien personnel change selon le secteur. Un peintre reconnu ne peut être remplacé. En revanche, un développeur peut l’être par un autre professionnel compétent.
L’auteur reste libre de refuser la commande tant qu’il n’a pas commencé à créer. Une fois la création entamée, il conserve son droit moral. Il peut peaufiner, modifier ou même renoncer à son œuvre jusqu’à sa divulgation. Toutefois, il ne peut pas se servir de ce droit pour échapper à la réalisation d’une œuvre conforme à la commande acceptée.
3) En cas d’inexécution du contrat de commande ou d’inachèvement : quels effets ?
Trois situations peuvent survenir : l’auteur refuse de créer, d’achever ou de livrer l’œuvre. Dans tous les cas, il perd sa rémunération. Le commanditaire se retrouve sans œuvre, mais la jurisprudence différencie ces cas pour déterminer les règles applicables.
Un juge ne peut pas forcer un auteur à créer. Il ne peut pas non plus imposer une astreinte. L’article 1221 du Code civil prévoit qu’une obligation de faire non exécutée devient une obligation d’indemniser. Toutefois, si le contrat ne repose pas fortement sur l’intuitus personae, la loi autorise parfois le remplacement. C’est le cas pour des notices techniques ou certains logiciels spécifiques. L’article 1222 du Code civil permet alors au commanditaire de limiter son préjudice.
Si l’auteur manque à ses engagements, il engage sa responsabilité contractuelle. Il doit alors réparer le préjudice subi et le gain manqué par le commanditaire. Une clause pénale permet d’anticiper ce risque : elle fixe à l’avance une indemnité forfaitaire en cas de non‑livraison.
4) Droit moral et transfert de propriété : des règles protectrices
Le droit moral de l’auteur est inaliénable. Il naît dès la création (art. L. 111‑1 du Code de la Propriété intellectuelle). Le commanditaire n’en devient jamais titulaire. Le transfert de propriété matérielle s’opère uniquement au moment de la livraison sans réserve, quand l’auteur exerce son droit de divulgation.
Si l’œuvre est achevée mais non agréée, elle reste la propriété de l’auteur, même si elle se trouve chez le commanditaire. Une œuvre entreposée, inachevée ou non signée ne vaut pas livraison. Il faut un acte clair de volonté pour que le transfert soit reconnu.
Toute clause qui prévoit une renonciation anticipée au droit moral ou au transfert est nulle. Elle viole l’ordre public en matière de propriété littéraire et artistique.
Conclusion
Le contrat de commande organise la relation entre un créateur et un commanditaire. L’auteur s’engage à produire une œuvre selon les termes convenus. Il bénéficie d’une liberté créative protégée par son droit moral. En cas d’inexécution, seule une indemnisation peut être exigée.
Conseil pratique : rédigez un cahier des charges précis. Prévoyez une clause pénale claire pour anticiper les conséquences d’un défaut de livraison.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle, articles L. 111‑1 à L. 111‑4, L. 121‑1 à L. 121‑6, L. 131‑1 à L. 131‑9, L. 132‑31
- Ordonnance n° 2014‑1348 du 12 novembre 2014 relative au contrat d’édition