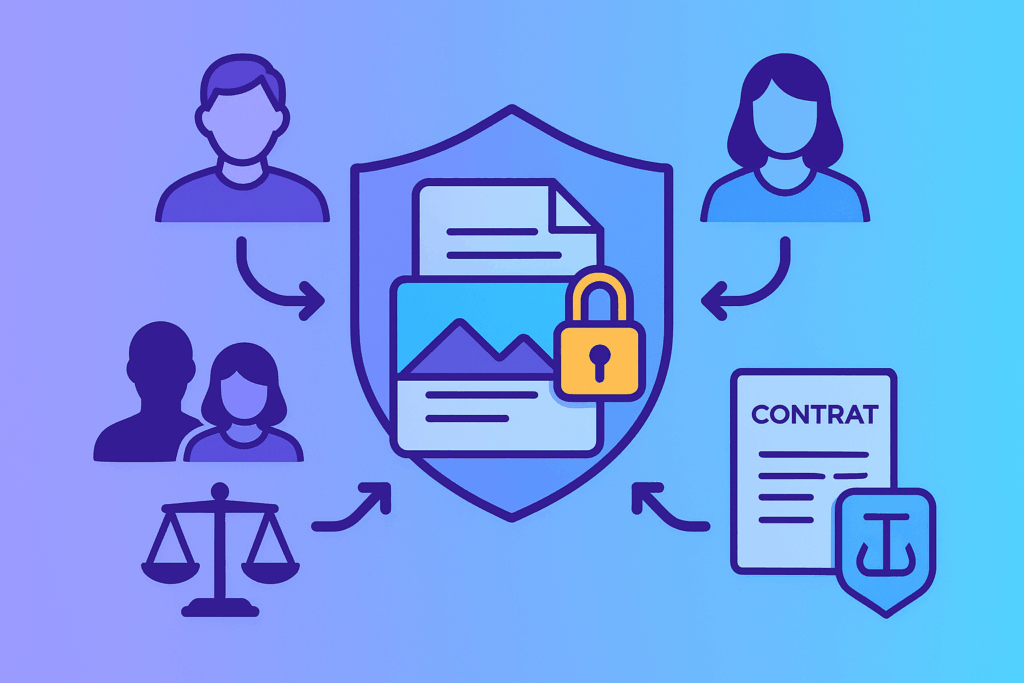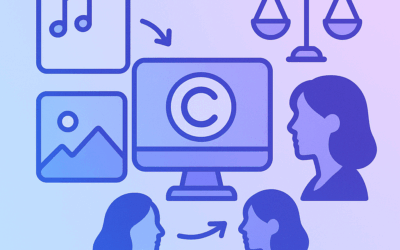L’œuvre collective crée un droit d’auteur direct au profit de l’initiateur. Elle fait fusionner plusieurs apports, sans céder les droits individuels. Plongez dans cette exception juridique essentielle en propriété intellectuelle.
1) Les fondements légaux de l’œuvre collective
Le Code de la propriété intellectuelle définit l’œuvre collective à l’article L. 113‑2. Elle naît sur l’initiative d’une personne physique ou morale. Ensuite, cette entité édite, publie et divulgue l’œuvre sous son nom et sa direction. Dans ce cadre, les contributions des auteurs se fondent dans un ensemble unique, empêchant tout droit distinct.
Ainsi, cette création sort du régime classique où chaque auteur conserve ses droits. Au contraire, la fiction légale investit directement l’initiateur de la qualité de titulaire originaire des droits.
2) Initiative et direction : un contrôle intellectuel
L’initiateur de l’œuvre collective doit démontrer son rôle moteur : il conçoit le projet, fixe la ligne éditoriale et structure l’ensemble. En outre, il coordonne les auteurs, oriente le style et harmonise les apports. Cette direction intellectuelle dépasse la simple maîtrise technique. Elle s’exprime par des instructions esthétiques, des choix stratégiques et un pilotage permanent.
Cependant, le pouvoir de validation ou de contrôle hiérarchique ne suffit pas. Il faut un engagement intellectuel fort, garantissant l’unité de l’œuvre.
Enfin, l’initiateur de l’œuvre collective peut déléguer tout ou partie de cette coordination à un salarié, mais c’est toujours l’entreprise ou la personne à son nom qui porte l’initiative.
3) Fusion des contributions et conséquences juridiques dans l’œuvre collective
La fusion signifie que chaque apport devient indissociable : les contributions individuelles se diluent dans l’œuvre finale.
L’identification des apports ne rompt pas cette qualification. Les dictionnaires citent leurs auteurs sans perdre leur caractère collectif. Cependant, cette fusion prive les contributeurs de droits patrimoniaux sur l’ensemble. Ils ne peuvent s’opposer à l’exploitation ni réclamer une part des revenus. Par contre, leurs droits sur leurs créations isolées restent possibles. Par exemple, un journaliste pourra republier son article en recueil, sauf clause contraire.
4) Titularité et portée des droits
L’article L. 113‑5 du Code de la Propriété intellectuelle prévoit que l’œuvre collective est présumée propriété de l’initiateur. Celui‑ci détient les droits patrimoniaux et moraux sur l’ensemble.
Néanmoins, la « preuve contraire » reste ouverte, mais l’usage pratique est rare. Plus souvent, la présomption facilite la gestion des droits pour les éditeurs et producteurs.
Ce régime soulève des critiques ; en effet, il réduit la participation financière et morale des auteurs. Il transforme la société ou la personne morale en « auteur » virtuel, ce qui heurte le concept même de droit d’auteur axé sur la personnalité.
Conclusion
L’œuvre collective constitue une exception majeure. Elle instaure une présomption originaire pour l’initiateur. Elle exige une initiative forte, une coordination intellectuelle et une fusion des apports. Ce régime simplifie l’exploitation. Mais il limite les droits des contributeurs.
Conseil pratique : formalisez dès le départ la répartition des rôles et la coordination intellectuelle par écrit pour sécuriser vos droits.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle, art. L. 113‑2 et L. 113‑5
- Cass. 1re civ., 19 déc. 2013, n° 12-26.409
- CA Paris, pôle 5, ch. 1, 21 sept. 2022, n° 20/13834
- Deshoulières Avocats, « Protéger ses droits d’auteur«