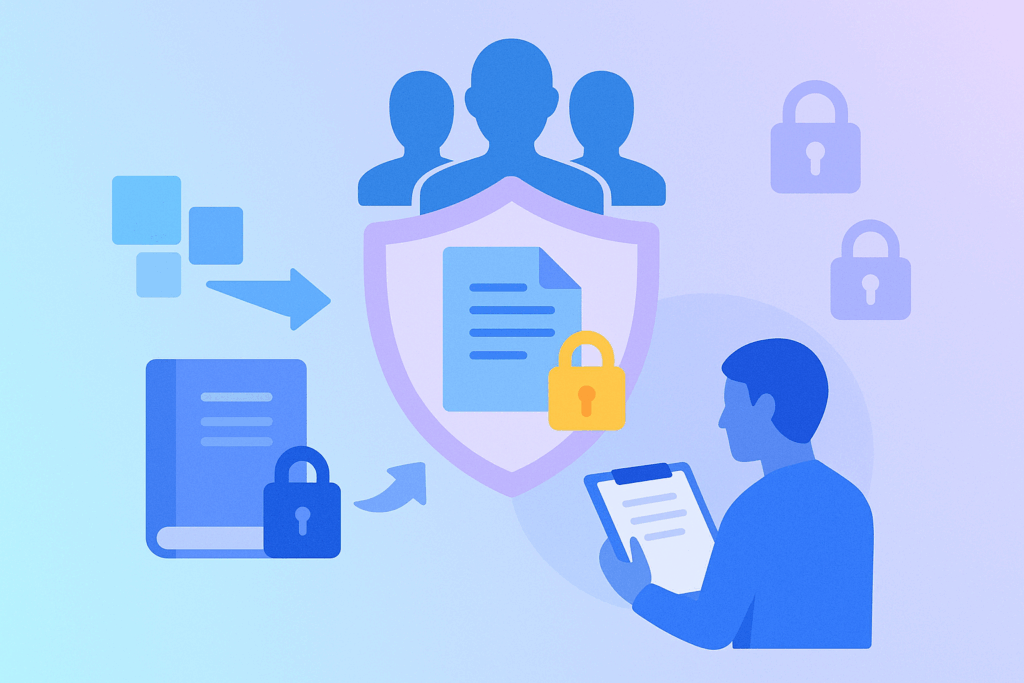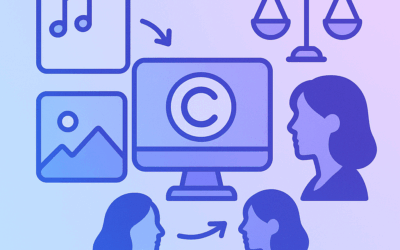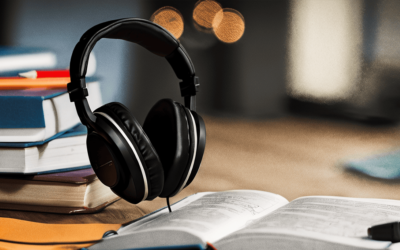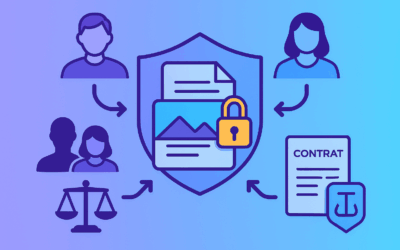La création à plusieurs est fréquente en droit d’auteur. Pourtant, comprendre le régime de l’œuvre de collaboration reste complexe. D’abord définie par la collaboration, l’indivision et le genre, cette notion exige un examen précis. Ensuite, son impact sur l’exploitation et la protection mérite attention.
1) Définir l’œuvre de collaboration en droit d’auteur
L’œuvre de collaboration naît de l’effort conjoint de plusieurs auteurs. Selon l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, elle suppose trois conditions.
- La participation de personnes physiques investies du statut d’auteur ;
- Une contribution effective à la conception ou à la mise en forme ;
- Une concertation durable entre les coauteurs.
En premier lieu, seuls les individus peuvent revendiquer la qualité d’auteur ; les personnes morales sont exclues, sauf pour l’œuvre collective. En outre, l’apport doit dépasser l’idée initiale. Ainsi, en pratique, la simple suggestion de thème n’offre pas la qualité de coauteur, comme confirmé par les arrêts « Être et avoir » ou la jurisprudence « Ivanhoé ». Enfin, la collaboration exige une « communauté d’inspiration » et un « mutuel contrôle », marque d’un travail créatif concerté. Cette exigence évite de confondre collaboration et simple addition d’apports indépendants.
2) Indivision et exercice des droits patrimoniaux dans l’œuvre de collaboration
L’article L. 113-3 du Code de la Propriété intellectuelle consacre l’indivision totale sur l’œuvre de collaboration. Concrètement, chaque coauteur possède l’intégralité de l’œuvre. Cependant, pour exploiter ou céder les droits patrimoniaux, l’unanimité est impérative. Si l’un des coauteurs s’oppose, tout acte d’exploitation devient illicite.
L’unanimité s’applique aux contrats d’édition, de représentation et de diffusion : sans accord collectif, l’exploitation constitue une contrefaçon. Les tribunaux sanctionnent sévèrement ces manquements. Ainsi, le juge civil joue un rôle d’arbitre lorsque la discorde bloque l’exploitation, en tranchant alors la question d’un accord préalable.
En revanche, chaque auteur conserve le droit moral personnel sur l’œuvre commune. Par exemple, pour demander le respect de la paternité ou s’opposer à une dénaturation, un seul coauteur peut agir si sa contribution est individualisée. Sinon, il doit impliquer légalement ses partenaires pour être recevable.
3) Œuvre audiovisuelle : une création collaborative par nature
La nature de l’œuvre audiovisuelle illustre bien le régime de collaboration. Par définition, le réalisateur, le scénariste et les auteurs de la musique « sont » coauteurs. L’article L. 113-7 du Code de la Propriété intellectuelle crée une présomption de qualité d’auteur pour ces professionnels.
- On y trouve notamment l’œuvre audiovisuelle, qualifiée d’oeuvre de collaboration par la loi. Il n’existe pas d’alternative pour ce type de création.
- La présomption simple désigne explicitement le réalisateur, l’auteur du scénario et les compositeurs comme titulaires initiaux des droits, sauf preuve contraire.
- Enfin, une ultime disposition assimile aussi les auteurs d’une œuvre préexistante incorporée, sous réserve d’un lien de filiation.
Ainsi, la jurisprudence a confirmé le statut de collaboration pour tout film cinématographique, documentaire ou jeu vidéo. Les agences publicitaires restent une exception rare, lorsque l’éditeur agenceur produit une œuvre collective.
4) Exploitation séparée et genres différents
L’article L. 113-3, alinéa 4, offre aux coauteurs la possibilité d’exploiter individuellement leur contribution. Cependant, deux conditions limitent ce droit :
- Chaque apport doit relever d’un genre différent.
- En outre, cette exploitation ne doit pas concurrencer l’œuvre commune.
D’une part, le mot « genre » désigne un art distinct, par exemple texte, musique ou image. Si deux contributions appartiennent au même genre, l’exploitation séparée devient impossible. D’autre part, l’exploitation individuelle ne doit pas nuire au succès de l’œuvre globale. Le tribunal apprécie alors le risque de confusion et la concurrence commerciale créée.
En pratique, ce régime reste peu utilisé. L’exigence de genres strictement différents et l’absence de préjudice rendent la séparation délicate. Pourtant, dans des contextes multimédias ou littéraires, il peut offrir une flexibilité pour réutiliser certains apports sans compromettre l’œuvre commune.
Conclusion
En somme, l’œuvre plurale conjugue collaboration, indivision et protection renforcée. D’abord, elle repose sur une contribution concertée et originale de plusieurs auteurs. Ensuite, l’indivision impose l’unanimité pour exploiter ou céder les droits patrimoniaux. Enfin, les règles spéciales de l’audiovisuel et l’exception d’exploitation séparée offrent des degrés de liberté mesurés. Pour sécuriser vos projets, structurez clairement les contributions et formalisez les accords dès la création.
Conseil pratique : rédigez un accord de collaboration dès la genèse pour définir les rôles, la gouvernance et l’exploitation future.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle, articles L. 113-1 à L. 113-7.
- Cass. 1re civ., 13 nov. 2008 (affaire « Être et avoir »).
- Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.728 (droit moral et mise en cause).
- Deshoulières Avocats, « Œuvre de l’esprit : comment protéger votre création ?«