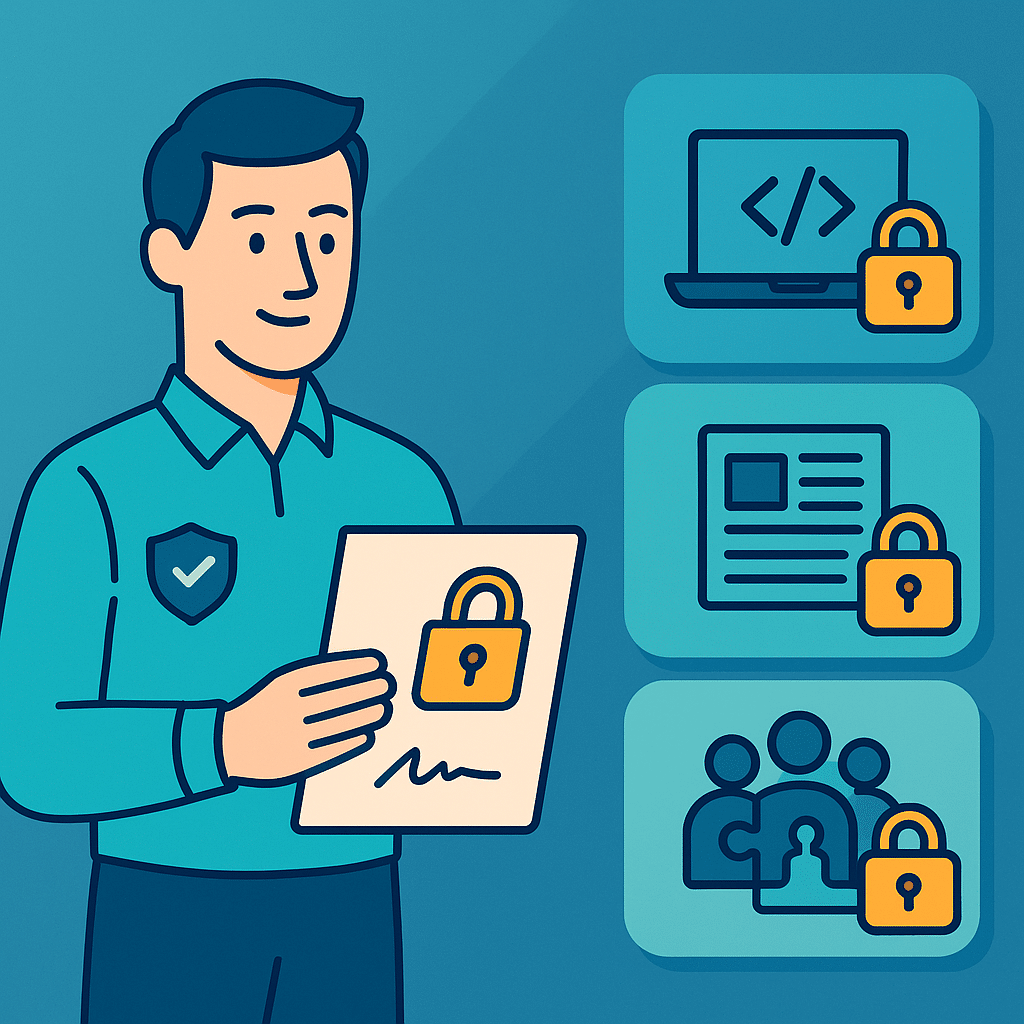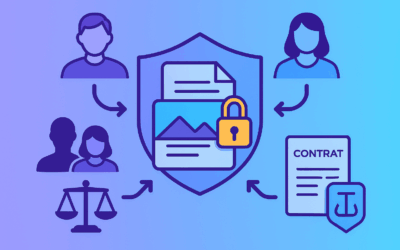Le droit d’auteur français place l’auteur au centre : dès qu’une œuvre naît, son créateur en possède les droits, même quand il est salarié. Pourtant, logiciels, articles de presse ou productions collectives, lorsque créations salariées, obéissent à des règles particulières concernant les droits patrimoniaux. Découvrez comment le principe, les exceptions et la jurisprudence s’entremêlent et apprenez à sécuriser vos contrats.
Les bases : le salarié, auteur avant tout
Le Code de la propriété intellectuelle est clair : créer suffit pour devenir titulaire des droits patrimoniaux des créations salariées. Le lien de subordination, même fort, ne retire rien à cette propriété. Pour qu’une cession soit valable, un écrit détaillé s’impose. Il doit lister chaque mode d’exploitation, leur durée, leur territoire et leur destination. Sans ce document précis, l’employeur ne peut ni publier ni adapter l’œuvre. La Cour de cassation, depuis 1975, confirme cette règle. Sa fermeté protège la liberté de création mais surprend encore beaucoup d’entreprises.
Les juges rappellent régulièrement que le salaire ne vaut pas cession. Ainsi, un photographe licencié a pu interdire la vente de ses clichés, faute d’acte clair. Toutefois, deux arrêts célèbres ont ouvert la porte à la cession tacite. En 2006, la Haute cour a jugé qu’un styliste, partie prenante au projet de sa société, avait implicitement transféré ses droits. La même solution a été envisagée pour un mandat d’agence artistique en 2012. Cependant, ces décisions restent isolées ; depuis 2015, la chambre sociale exige de nouveau un formalisme strict. Conclusion : comptez sur un contrat écrit, pas sur la bonne foi supposée des parties.
Première exception : le logiciel conçu par un salarié
Le programme informatique suit un régime dérogatoire concernant les oeuvres salariées. L’article L.113-9 opère une cession automatique des droits patrimoniaux à l’employeur, si trois conditions sont réunies.
- D’abord, un véritable logiciel doit exister : un code source ou au moins des documents préparatoires capables de devenir un programme.
- Ensuite, le créateur doit être salarié au moment du travail.
- Enfin, la conception doit se faire dans le cadre des fonctions ou sur instruction de l’employeur.
Quand ces critères sont remplis, l’entreprise devient titulaire de tous les droits patrimoniaux, sans limite de temps. Le salarié garde son droit moral, réduit au droit au nom et au respect du code. Un avenant peut toutefois prévoir une prime ou réserver certaines parties du logiciel au développeur.
Deuxième exception : l’œuvre journalistique et la cession par défaut
Depuis la loi du 12 juin 2009, les textes confèrent à l’éditeur d’un « titre de presse » une cession exclusive et automatique des articles, photos ou vidéos produits. Ainsi, cette cession couvre tous les supports du même titre, papier ou numérique, pendant une « période de référence » négociée par accord collectif. Au-delà, le journaliste reçoit une nouvelle rémunération.
La diffusion hors de la « famille cohérente » de presse reste soumise à l’accord exprès de l’auteur. Attention : pour les œuvres salariées antérieures à 2009, le journaliste peut toujours réclamer un complément si l’éditeur les réutilise sans autorisation.
Troisième exception : l’œuvre collective, une notion souple mais encadrée
Une œuvre est dite collective quand une personne, physique ou morale, prend l’initiative et la direction du projet, le publie sous son nom, et quand les contributions fusionnent dans un ensemble indivisible. Dans ce cas, l’initiateur acquiert d’office tous les droits, même moraux, sur le tout des créations salariées. La jurisprudence a reconnu cette qualification à des catalogues de luxe, des dessins de bijoux et des campagnes publicitaires.
Les juges observent deux points : l’employeur fixe-t-il l’esthétique ? Le salarié dispose-t-il d’une réelle autonomie créative ? Si la réponse est non, l’œuvre est souvent collective. Dès lors, certains contrats prévoient d’ailleurs une clause qui présume ce caractère ; la charge de la preuve inverse alors au détriment du salarié.
Conclusion
Le principe reste simple : l’auteur salarié détient les droits patrimoniaux sur les créations salariées, sauf texte spécial. Pour les logiciels, le journalisme et les œuvres collectives, la loi renverse la règle. Employeurs : rédigez des clauses claires, signez des avenants lors de chaque nouvel usage et conservez les preuves. Salariés : gardez vos fichiers sources et vos échanges. Un contrat bien pensé protège la créativité et évite les procès.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :
- Code de la propriété intellectuelle, art. L.111-1, L.113-9, L.131-3, L.132-35 à L.132-40
- Cass. 1re civ., 16 déc. 1992
- Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-19 294
- Loi n° 2009-669, 12 juin 2009, droits des journalistes
- Deshoulières Avocats, « Créations salariées et détention des droits patrimoniaux »