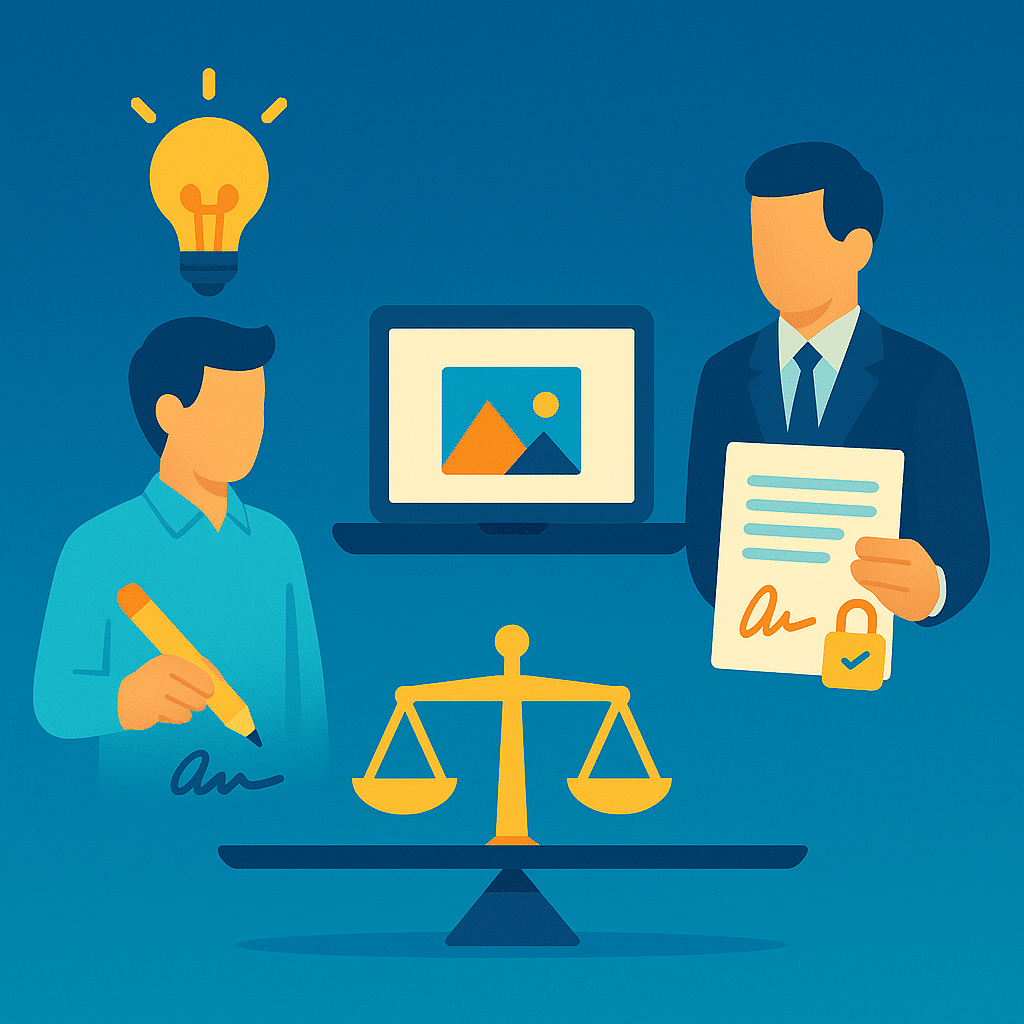Le salarié peut-il revendiquer la paternité et les revenus d’une œuvre réalisée sur le temps de travail ? Oui, car la loi place l’auteur au cœur du droit d’auteur, même sous subordination dans le cadre de créations salariées. Cependant, l’employeur peut exploiter cette création s’il respecte un strict formalisme de cession. Comprendre cet équilibre protège votre entreprise comme votre carrière créative.
Salarié créateur : auteur avant tout, mais sous preuve d’originalité dans les créations salariées
D’abord, dans le cadre des créations salariées, l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle proclame que le droit naît du simple fait de la création, sans distinction entre auteur indépendant et salarié.
Ensuite, la Cour de cassation rappelle que l’existence d’un contrat de travail n’écarte aucun droit moral ni patrimonial. Cependant, le salarié doit démontrer deux points :
- L’existence d’une œuvre de l’esprit ;
- Son originalité. Sans empreinte personnelle, pas de protection.
Les juges observent aussi le degré de subordination : plus l’employeur dicte la forme, moins l’originalité apparaît. Ainsi, une styliste tenue d’appliquer un cahier des charges précis n’a pas obtenu la qualité d’auteur. À l’inverse, un graphiste libre dans ses choix créatifs reste titulaire de ses droits.
Enfin, pour gagner un procès, le salarié doit dater sa création et prouver qu’il en est bien l’initiateur, exigence souvent négligée dans la vie de bureau.
Céder les droits des créations salariées à l’employeur : l’écrit précis comme clé de voûte
Ensuite, l’article L.131-3 impose une cession expresse, séparée pour chaque droit (reproduction, représentation, adaptation) et limitée par destination, durée et territoire. Une clause globale insérée dans le contrat de travail ne suffit pas. Si elle se contente d’indiquer que « le salaire couvre la cession de tous droits », elle est nulle ; l’exploitation devient contrefaçon. La jurisprudence l’illustre : l’AFP condamnée pour avoir numérisé des photos quand la clause ne visait pas ce mode d’exploitation.
Cependant, les parties peuvent anticiper les supports futurs grâce à l’article L.131-6, à condition de prévoir une participation aux profits correspondants.
Enfin, la prohibition des cessions globales d’œuvres futures bloque toute tentative d’appropriation automatique de la production à venir. Pour sécuriser l’activité, le droit offre un outil plus souple : le pacte de préférence. Par ce mécanisme, le salarié s’engage à proposer en priorité ses futures œuvres, dans un genre déterminé, à son employeur, sans céder d’avance les droits.
Clauses sensibles et pièges contractuels : l’art du dosage
Cependant, la pratique révèle des clauses ambiguës. Beaucoup prévoient une cession « au fur et à mesure des créations ». La cour de Versailles a validé une telle clause parce qu’elle limitait la cession aux œuvres déterminables : celles réalisées dans le cadre précis du poste. En revanche, une cour d’appel a annulé une clause similaire qui manquait de bornes claires.
L’enjeu principal réside donc dans la précision : énumérer les modes d’exploitation visés, fixer un périmètre géographique et indiquer une durée, même si elle couvre toute la protection légale. Par ailleurs, toute modification de ces paramètres nécessite l’accord du salarié ; son refus ne constitue pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Enfin, les savoir-faire non protégés par le droit d’auteur, mais vitaux pour l’entreprise, appellent d’autres outils : clauses de confidentialité, non-concurrence ou exclusivité. Ces stipulations protègent l’employeur sans empiéter sur les droits moraux.
Rupture du contrat : l’épreuve du feu contentieuse
Le litige éclate souvent après la rupture du contrat. Le salarié réclame alors une rémunération complémentaire pour l’exploitation de ses œuvres ; l’employeur brandit parfois ces mêmes œuvres pour justifier le licenciement. Les juges examinent d’abord l’existence d’un écrit de cession régulier. S’il manque, l’employeur peut être condamné pour contrefaçon, même s’il a financé la création.
Ensuite, ils évaluent l’originalité. Une salariée qui se contente d’exécuter des directives sans choix créatif perd son action. Cependant, lorsque l’employeur exploite des œuvres clairement originales sans cession valable, il doit réparer le préjudice patrimonial et moral. Les montants peuvent être élevés : dommages-intérêts, restitution des profits, interdiction de diffusion. Pour éviter ce scénario, mieux vaut négocier un avenant de cession conforme dès l’embauche ou avant toute publication.
Conclusion
Le droit d’auteur reconnaît pleinement le salarié créateur, mais autorise le transfert de ses droits si, et seulement si, la cession est écrite, détaillée et équilibrée. Entreprise : sécurisez vos projets en rédigeant des clauses précises et adaptées. Salarié : conservez la preuve de votre apport personnel et vérifiez chaque avenant. Ainsi, la création s’épanouit sans contentieux.
Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans vos litiges en propriété intellectuelle.
RESSOURCES :
-
- Code de la propriété intellectuelle, art. L.111-1, L.131-1, L.131-3
- Cass. 1ʳᵉ civ., 16 déc. 1992, arrêt de principe « titularité initiale »
- CA Paris, 9 juin 2009, AFP : contrefaçon faute de cession numérique
- Cass. soc., 7 janv. 2015